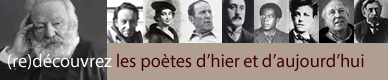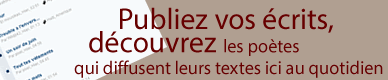Facino Cane, qui demeurait alors rue de Lesdiguières, mâavait initié à lâart de la flânerie. « Quand il faisait beau », mâavait-il confié un soir de pluie, « à peine me promenais-je sur le boulevard Bourdon »[1]. Comme il faisait rarement une chaleur de trente trois degrés boulevard Bourdon[2], il préférait se mêler aux passants depuis le boulevard du Pont-aux-Choux jusquâau boulevard Beaumarchais. Pour éviter de le gêner dans son exercice préféré, jâallais mâexercer à son art dans un autre quartier de Paris. Sortant de la Bibliothèque jadis impériale et nationale, je mâengageais dans la rue de Richelieu vers le nord, jusquâau boulevard des Italiens. Cessant de musarder, je mâinstallais à une terrasse de café. Pour peu que jâaie terminé plus tôt que prévu mes devoirs de lecture, jâempruntais volontiers la rue Vivienne puis le passage des Panoramas et, de lâautre côté du boulevard Montmartre, celui de Jouffroy. On a lâimpression dâêtre dans le décor dâun couloir de château ; chaque chambre est une boutique, lâune consacrée aux éventails, lâautre aux estampes, une encore aux fanfreluches. La lumière des verrières est jaune et les promeneurs se croient suffisamment masqués pour suivre des yeux les vendeuses derrière les mannequins. Au coude du passage, un hôtel si agréablement théâtral quâil doit être hanté de nos vies antérieures.
Très jeune jâai ressenti du plaisir à suivre une femme dans la rue. Enfant ce fut ma mère que jâinquiétais en feignant de me cacher. Adolescent les amies de ma mère, puis celles de ma sÅur. Câest ainsi que (mais cet aveu me coûte), à quinze ans, je me sentis irrépressiblement attiré par lâautre. Hérétique pour les sévères, hétérodoxe pour les plus indulgents, je me réjouissais de pouvoir détailler un corps avec une attention proche de lâimpertinence. On a besoin dâêtre seul, câest à dire silencieux, pour contempler la multitude animée par la parlerie, la gravitation « des mondes de douleurs et des univers de joie en promenade sur les Boulevards ou errant par les rues »[3]. Et retenir dans ce tourbillon un élément de fascination. La terrasse dâun café, dans la douceur du soir est un endroit rêvé. Câest lâéquivalent dâune falaise dâoù on peut imaginer les tempêtes humaines : « suave mari magno turbantibus aequora ventis⦠»[4]. Il est toujours agréable dâêtre indiscret, mais plus encore de se croire indemne des douleurs que lâon prête à autrui. On compatit aux misères humaines pour suavement se réjouir dâêtre exempt des maux dont on constate les effets. Le charme de la curiosité tient tout entier dans lâinterprétation quâelle suscite. Suivant les quartiers, les romans quâon se fait diffèrent. A la Bastille, rien ne trouble plus que les adolescentes ; à lâîle de la Cité, rien nâest plus attachant que lâignorance contemplative des adultes. La démarche des jeunes filles est féline, leurs propos délurés. Comme depuis un bout de temps je suis transparent à leur regard, je puis détailler leur nuque longue, leur taille menue et, dans des pantalons étroits, leurs fesses dandinantes. Aguichantes, turbulentes, mélancoliques et impudiques, elles paraissent les esprits des eaux, rarement claires, souvent troubles. Comme il ne présente pas dâintérêt touristique, le boulevard Henri IV est souvent désert. Passé lâîle Saint-Louis, les blondes et les rondes, les chauves et les séducteurs alternent, en un mouvement indéterminé. Lâaisance assure la hauteur des voix, que troublent les injures des plus pauvres. Assis sur les trottoirs, ils pestent de ne plus être dans le tourbillon. Valse désordonnée avec des franges immobiles. Les jeunes, rieurs, et les voyageuses lasses. Il y a si longtemps quâelles rêvent de ce lieu comme de celui du bonheur, quâelles ne parviennent pas à sâassurer de voir ce quâelles regardent.
Parfois poussant au-delà de la rue de lâArbre-sec, je franchissais le carrefour de Buci. Les rêveries alors se faisaient tout autre ; lâattention se détournait des grisettes et des prudes pour se porter sur les duchesses quâelles fussent de Maufrigneuse ou de Langeais. Mais les plus lisses, les plus impassiblement douloureuses faisaient de moi un ami de Peter Ibbetson. Jâévitais dâattirer un regard qui eût brisé le rêve. Mon attention aux passants devenait alors romanesque. Je ressentais le besoin de leur prêter une histoire, définitive et futile. Les couples à Saint-Germain paraissent indifférents lâun à lâautre ; les jeunes femmes ont été conçues dans une boutique de luxe (la froideur est de mise, et la passion vulgaire) ; les hommes veillent à être négligés, jean effrangé, pieds nus dans les mocassins. Lui sirotait un alcool, elle une orange pressée sans sucre. Désintéressée du spectacle et de son partenaire, elle regardait ailleurs à travers ses lunettes ténébreuses. La jupe haut relevée, les jambes lisses croisées, se creuse le sillon entre les muscles de la cuisse, tandis quâelle ramène vers elle la pointe de son pied, rendant menaçante la longue aiguille du talon. Quand les couples étaient assortis, câétait pire : tous deux heureux dâêtre ce quâils étaient ; ce qui était la sagesse même. Lââge les avait ternis ; ils sâauréolaient dâêtre dans la fraîcheur et lâélégance, estimaient du regard leur voisin, galbé bien que bombé.
Sitôt servi, je réglais ma consommation ; je pouvais ainsi mâesquiver quand ceux qui avaient retenu mon attention, dâun seul mot échangé, se retiraient. Où allaient-ils ? Et sâils devaient se séparer, comment le feraient-ils ? Le roman dâune personne se construit à partir de sa démarche. Du visage, on ne retient en mémoire quâun masque ; dévisager quelquâun nâen permet pas lâapproche : facies sans vultus. Il faut mettre ses pas dans dâautres pas pour prêter à autrui une histoire plausible. Les talons de leurs chaussures et leurs poignets de chemise trahissent les hommes ; le déhanchement dâune femme, son port de tête disent bien plus que son nom. Les pendentifs aux oreilles et les bracelets à breloques témoignent de bien des espérances mêlées aux souffrances des yeux ternes. Plutôt que de retourner vers lâAmbigu-Comique pour guetter la sortie du public, je me contentais de celle des cinémas du boulevard, quand les enfants se libèrent dâavoir été patients, et que les couples se resserrent pour entre ensemble dans la nuit : « En entendant ces gens, je pouvais épouser leur vie, je me sentais leurs guenilles sur le dos ; je marchais les pieds dans leurs souliers percés ; leurs désirs, leurs besoins, tout passait dans mon âme, ou mon âme passait dans la leur. Câétait le rêve dâun homme éveillé »[5]. Les personnes que jâécoutais indiscrètement devenaient les personnages dâun roman que je nâécrirai jamais. « Vous ne sauriez imaginer combien dâaventures perdues, combien de drames oubliés dans cette ville de douleur »[6]. La tête du flâneur est pleine dâhistoires qui nâattendent que le passant pour sâincarner. Comme il faisait un temps agréable, les promeneurs étaient nombreux sur le boulevard. Il suffisait de les regarder puis de les inventer, pour pratiquer lâexercice qui consiste à sâoublier jusquâà devenir étranger à soi ; « quitter ses habitudes, devenir un autre que soi par lâivresse des facultés morales, et jouer ce jeu à volonté, telle était ma distraction »[7].
Ainsi croit-on se distraire de la solitude en contemplant la foule. Mais il y a une solitude choisie, celle du rêveur, une solitude imposée, celle de lâexclu. Il y a également deux aspects de la foule, celle à laquelle on peut se mêler, en suivant une lorette ou un agent secret, ou bien en manifestant sous le drapeau noir. On est avec des proches inconnus. Et une autre foule, celle des errants, des étrangers qui montent à la ville, et ne trouvent pas à se fixer. A celui qui est seul, la foule paraît une juxtaposition de solitaires : « Inconnu, je me mêlais à la foule : vaste désert dâhommes », pleure René après avoir perdu Amélie[8]. Nous prêtons à la multitude les caractères de notre solitude. Quand Octave de T*** rentre à Paris, il est frappé par lâaspect tumultueux de la ville ; les habitants sont ensemble et séparés : « Oh ! quelle solitude ! » lui fait dire Musset. La ville est un lupanar « où les corps seuls sont en société, laissant les âmes solitaires, et où il nây a que les prostituées qui vous tendent la main au passage ! »[9]. Lâêtre le plus dédaigné se révèle le plus charitable et la ville lâespace de la plus profonde solitude. La littérature du XIXe siècle a été sensible à lâabsence de communauté. Au début du siècle, la solitude est tenue pour un signe dâélection ; à la fin, les célibataires de Huysmans nâen finissent pas de mourir à eux-mêmes. Ils vivent de rien , et ne rêvent à rien. La nature même perdra ses petits dieux écrasés par le bitume. Le poète-prophète tient la multitude pour hostile : la foule, câest lâuniformité bourgeoise, selon Chatterton ; son emportement, dès quâelle est populaire, effraie Stello ; échappant à la conduite des meilleurs, elle est essentiellement barbare ; sa vigueur cependant est porteuse dâavenir nous dit Vigny dans Daphné. Hugo, Michelet, Zola, la louent pour lâindivision de son élan.
La multitude est inquiétante pour ceux que la solitude prive de semblables (câest le cas des mouvements révolutionnaires, irrationnels pour Goncourt). Et la solitude subie est dévastation de soi ; dès lors le monde est un désert. Ou elle est choisie ; elle devient alors lâéquivalent de la retraite religieuse. Dans le Spleen de Paris, Baudelaire reprend à son compte la démarche de Balzac : le flâneur est « comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre quand il veut dans le personnage de chacun »[10]. Dans ce poème les mots « multitude » et « solitude » sont juxtaposés. Ce ne sont pas des contraires mais des termes associés : « qui ne sait pas peupler sa solitude ne sait pas non plus être seul dans la foule affairée ». La multitude est un composé de solitudes ; la solitude est un espace de contemplation. Le flâneur voit autrui comme un part intime de lui ; tout en se mêlant à la foule, il conserve son don dâobservation, ce qui le met à part. Il est sensible « à lâimprévu qui se montre, à lâinconnu qui passe ».
La flânerie implique une disposition libre du temps, alors que le propre de la foule est lâaffairement. Le flâneur nâest pas seulement observateur, mais compatissant ; il nâest pas craintif, mais attentif à autrui comme à une part de soi. La foule nâest pas une masse anonyme ; elle est une ensemble dâindividus qui déguisent en elle leur solitude. Cette double postulation, expansion de soi dans la foule, solitude dans le repli méditatif, est celle de lâécrivain se retrouvant en se promenant dans lâespace des mots.
A Paris, au jardin du Luxembourg, lâoccasion est donnée de faire connaissance avec soi par lâattention portée à autrui : « Je rencontre, dans les allées détournées, des misérables qui fuient la vue des heureux, des vieillards qui cachent la honte de leur pauvreté », écrivait Vauvenargues, se penchant « Sur les misères cachées »[11]. Lisant cette page, Baudelaire est sensible à une perversité dâesprit : la compagnie des exclus séduit le solitaire. En « Des êtres singuliers, décrépits et charmants », il voit des frères en dénuement. Dans les admirables poèmes consacrés aux « Petites vieilles » (Les Fleurs du Mal, XLI) et aux « Veuves » (Spleen de Paris, XIII), il se pose tout dâabord les questions balzaciennes, déchiffrant sur le vêtement et le visage « les innombrables légendes de lâamour trompé, du dévouement méconnu, des efforts non récompensés, de la faim et du froid humblement, silencieusement supportés »[12]. Puis sâinterroge sur une de ces femmes en grand deuil, qui fréquente un misérable café puis écoute le concert du soir, se tenant à lâécart du kiosque à musique : « un parfum de hautaine vertu émanait de toute sa personne ». Et cependant il demeure de ce quâil y a de déloyal dans la compassion : lâautre est mon semblable ; mais puisque je puis encore le penser, câest que je demeure autre.
La multitude et la solitude échangent leurs qualités comme si le divers et lâun alternaient. Dans Mon cÅur mis à nu, Baudelaire donne à cette attitude sa formule : « De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là »[13] ; ce quâil reprend dans Fusées : « le plaisir dâêtre dans les foules est une expansion mystérieuse de la jouissance de la multiplication du nombre »[14]. Câest une forme, comme la création, de prostitution.
Poe est à Londres de 1827 à 1830. Il est sensible à la façon dont les classes sociales, lâaristocratie entamant son déclin, la bourgeoisie sâaffairant, le prolétariat se multipliant, le sous-prolétariat se désespérant, déambulent sans se côtoyer. Suivant les heures du jour, la population change du tout au tout. Relevant de maladie (la convalescence est un temps de disponibilité), le narrateur se sent envahi dâune émotion nouvelle. Poe détaille les personnages qui se suivent comme en cortège, les bourgeois, les commis, les prostituées, les ivrognes, remarquant un pauvre diable inclassable. Pour comprendre son comportement, il fait toutes les suppositions possibles : « Ce vieux homme, â me dis-je à la longue, â est le type et le génie du crime profond. Il refuse dâêtre seul. Il est lâhomme des foules »[15]. La foule serait une juxtaposition de solitaires qui fuiraient leur solitude, cherchant dans la promiscuité à échapper à lâanonymat. Pascal nâaurait pas plus sévèrement condamné le vieil homme, non pour son goût des tavernes, mais pour son besoin de se fuir. Baudelaire a traduit ce récit et publié en 1856 cette « nouvelle histoire extraordinaire » cinq ans avant de faire paraître, en 1861, « Les Veuves » et « Les Foules ». Dans ces poèmes, Baudelaire reprend, au double sens du terme, Poe ; il répète le thème mais en lui donnant une autre morale ; la capacité de souffrance lie la solitude et la multitude : je mâidentifie à ceux que je perçois, et me découvre dans lâattention que je leur porte. Le narrateur de « Lâhomme des foules » est intrigué par le comportement du vieillard ; Baudelaire par lâêtre même des « Petites vieilles ». Il ne suffit pas dâobserver le défilé de la foule, de distinguer en elle la précipitation des travailleurs, la célérité des commis, la nonchalance des élégantes, le train lent des retraités ; mais de porter son attention à ce qui ne se montre pas, et dâavoir pour celle qui, peureuses, le dos rond, côtoient les murs, une attention tout à la fois aimante, et diabolique :
« Mon cÅur multiplié jouit de tous vos vices !
Mon âme resplendit de toutes vos vertus ! »[16]
Car le flâneur est comme lâenfant un pervers polymorphe. Sa pitié est une jouissance, et un dévoilement. La vue de la multitude délivre dâun danger de la solitude : être seul en se pensant seul digne de lâêtre, et de souffrir de lâêtre. Le flâneur est un artiste car il travaille à se défaire de la complaisance à se croire exempt des misères dâautrui.
Du temps que jâétais jeune, je me pensais sur la rive ; jâassistais à des naufrages, sans mâémouvoir puisque jâétais immortel, et que la vieillesse ne ridait que les gens âgés. Les veuves de quarante ans tout de noir vêtues, un vieil oncle paralysé bavant, les vieilles gens constituaient pour lâenfant une classe à part : les plus anciens que lui sont nécessairement nés vieux. Il lui faudra éprouver le temps et le mal. Et admettre quâils vivent en lui. Une fois par semaine, une grande femme mince, qui dut être belle tant son visage émacié a gardé de noblesse, traîne ses hardes, un sac de couchage déroulé, quelques chiffons pour les pieds, un châle sur les épaules, dans la rue du Commerce. Dès le milieu de la matinée, elle sâassied, lasse, à lâentrée fermée dâun détaillant. Aucune sébile à ses pieds ; elle ne tend pas la main ; elle ne demande rien, trop épuisée même pour répondre dâun regard à lâoffrande qui lui est faite. Les mots que je lui disais ne la ressusciteraient pas, lui rappelant que les pauvres seraient les premiers, la révolution faite. Mais la révolution, câest toujours pour après la vie et au-delà de la souffrance. Où ira-t-elle quand va venir le soir ? Les souvenirs de sa vie passée la martyrisent-ils ? Est-elle sans espérance dans la croisade des enfants ? Passant près dâelle, les passants sâaffairent ; il y a les gâteaux à acheter à la sortie de la messe. Câest un beau dimanche. Je devrais lâinviter chez moi ; elle nâen serait pas effarouchée tant il émane dâelle « un parfum de hautaine vertu ». Mais je suis encore trop avare de solitude. Car la mienne, je lâai choisie ; et la sienne lui est si lourdement imposée quâelle est dépossédée de ses ancêtres, et privée de ses semblables. Ces abandonnés, ces rejetés, le monde des morts, ils le connaissent : câest un espace où des spectres sans passé ni avenir sont sans parole. Ce ne sont pas seulement le froid et la faim qui les abattent, mais lâindifférence : ils sont hors de tout regard. Baudelaire a raison dâépargner le vin dans sa condamnation des stupéfiants : les yeux des drogués sont vides ; la voix des autres, coléreuse. Les uns considèrent la multitude comme une suite dâombres ; pour les autres, il nây a devant eux que les boues dâun égout triomphant. Ces pauvres êtres dépenaillés, quelle que soit notre ivresse, ou notre soin à nous fondre dans la multitude, nous sommes incapables de ne pas les distinguer au bord du chemin entre les dépôts de nos détritus, ces pauvres êtres déjetés, jeunes vieillards et vieilles femmes aux pupilles délavées,
« Les yeux sont des puits faits dâun million de larmes »[17]
Ils ont le visage de tous ceux dont nous avons fait nos victimes. Notre attention même les accable.
Quand la chaleur nâest pas excessive, câest un bonheur « dâépouser la foule ». Câest, dit encore Baudelaire, « une immense jouissance que dâélire domicile dans le nombre, dans lâondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et lâinfini »[18]. La foule est un miroir de soi où le flâneur apparaît dans sa diversité. Insatiable de ses reflets, chacun de nous savoure dans la foule son infinité. Il suffit de la regarder pour se multiplier, pour sâoublier. Tel est le lecteur, grand prostitué. Les personnages ne vivent pas à notre place : ils nous donnent à connaître nos vies virtuelles. Ayant passé de la connaissance dâun destin à celle dâun autre, le lecteur se retrouve seul au soir de sa vie, ayant aimé en tous, délaissé par tous, seul sans solitude, nâayant jamais été autre quâune multitude de fantômes, boulevard Bourdon.
Jean Roudaut
[1] Balzac, Facino Cane, La Comédie humaine, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1977, t. VI, p. 1019.
[2] Selon Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chapitre 1.
[3] Balzac, Gaudissart II, éd. cit., t. VII, p. 847.
[4] Lucrèce, De Natura rerum, II, 1-2 : « Il est doux, quand sur la grande mer les vents soulèvent les flots, dâassister de la terre aux rudes épreuves dâautrui » (traduction dâAlfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 1948, t. I, p. 42).
[5] Facino Cane, éd. cit., p. 1020.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Chateaubriand, Åuvres romanesques et voyages, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1969, p. 127.
[9] La Confession dâun enfant du siècle, I, 10, dans : Åuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971, p. 107.
[10] « Les Foules », Åuvres poétiques, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, t. I, p. 291.
[11] Åuvres (1857), cité dans : Baudelaire, Åuvres complètes, éd. cit., t. I, p. 1316-1317.
[12] « Les Veuves », Spleen de Paris, XIII, éd. cit., p. 292.
[13] Op. cit., p. 677.
[14] Op. cit., p. 649.
[15] Prose, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 332.
[16] « Les Petites Vieilles », Les Fleurs du Mal, XCI, éd. cit., p. 91.
[17] « Les Petites Vieilles », Les Fleurs du Mal, XCI, éd. cit., p. 89.
[18] « Le peintre de la vie moderne », Åuvres complètes, éd. cit., t. II (1976), p. 690.
Voir l'article complet