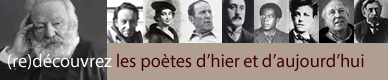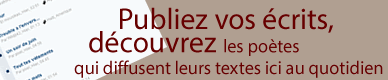De Martine Broda jâaimerais ne dire que des choses justes ; et comme sa vie fut passionnée, violente, dont nous sommes les témoins, en écarter les réductions médisantes et les amplifications disproportionnantes.
Avec la poésie, il est question dâinspiration. Les sources en sont diverses et « le poète » une figure qui se prête à la typologie. Pas de poète sans « légende » ? Et la légende de lâune â ici Martine â fait entrer sa figure sous un type, celui de la lyrique amoureuse. Martine Broda était inspirée. Ce qui veut dire dâabord éduquée par de grands inspirateurs, quâelle eût dit à célébrer.
De Jouve à Celan, de Rilke à Benjamin, de Charles Racine à Juarroz, de la tradition dâOc à Hölderlin ou Hopkins ; mais aussi Freud, Lacan, les maîtres de la philosophie ; et parmi les vivants, ceux quâelle aimait, sa biographie relèvera les rencontres qui la formèrent, où sâapposent les noms dâamis, eux-mêmes connus ou peu connus, peu importe, Antoine Berman, Gisèle de Lestrange ou Bertrand Badiou, Patrick Lévy ou Dominique de Villepin⦠(beaucoup dâautres que je connais, et que je ne connais pas).
Traductrice, germaniste, philosophe, juive, extrême laborieuse dans sa vocation (son métier en fit une directrice de recherche au CNRS), pour nous ses témoins, sa vie se changeait en éclats, en douleurs, en victoires ,« dignes dâêtre racontés ». Nous nous relations ses irruptions, et les crises, dans nos existences, et sa vie entravée de difficultés croissant avec lââge. Elle souscrivit à son signe (eût dit Charles Racine).
« La brûlure est réelle », scande son livre Grand Jour â où je relis cet autoportrait qui est aussi, bien sûr, portrait de lâune des sÅurs en art â dont le genre lyrique prescrit la fécondité : « Cette femme ou rose efflanquée/ habitait la rigueur/ elle aiguisait sa jeunesse/ une souffrance de cristal/ rallumant sans faiblir/ la bougie de faim plus claire/ la parole gravée/ par lâépine porte-rose dans son cÅur » [1].
Sa vie amoureuse, et je dirais sans lâombre dâune ironie, superstitieuse, puisque par là jâindique sa relation nocturne aux morts qui vivaient avec elle, lâenlaçait à sa perte, comme dit le poème qui sâachève ainsi : « je ne tiens plus à toi que par un lambeau (â¦) de toute ma douleur »[2]. Son commerce avec les morts lâentretenait. La vie en poésie nâétait pas que confection du poème mais, nuit et jour, tenait à la visitation.
Pour faire comprendre à dâautres cet apparent paradoxe quâ il lui arrivait souvent de déclarer, déconcertante, quâil lui fallait maintenant trouver des tâches nouvelles, quâelle était en panne de sujet, et câest ainsi quâelle sâattacha à Roberto Juarroz, je dirais quâelle a été didactique : elle reconduisait ainsi de jeunes lecteurs de plus en plus détournés de la poésie vers et dans la tradition lyrique, de Guillaume dâAquitaine à Jouve, devenue opaque par ignorance scolaire ou offusquée par le tournant culturel. Passeuse, si lâon veut, assez pédagogue pour des lecteurs. Translatio poetarum. Elle passait le relais de Rilke à Hölderlin, de Mandelstam à Juarroz, et de la psychanalyse à la sublimation.
Elle sâest faite exemple, comme un Tibétain qui sâincendie devant tous, pour prouver (suicidée de la poésie ?), preuve vivante brûlante de ce à quoi elle se vouait et dévouait : le sens de la poésie, la Chose : « le lyrisme soit le chant qui advient au sujet avec sa propre dépossession, quand il sâexpose à la rencontre dâune altérité transcendante et radicale »[3]. Et malgré elle la poésie culturelle continue, bien sûr, à écarter du poème (écrit) et de lâétude de la translatio, pour les plaisirs de lâaccompagnement, un peu musical, de la distraction de vivre la vie ordinaire mondialisée.
Ainsi était-elle contre son temps : « Aujourdâhui en France la poésie, perdant contact avec son public au fur et à mesure quâelle renonce à toute dimension existentielle, éthique et destinale, a tendance à sâépuiser dans des jeux parodiques, ou encore à devenir exsangue »[4].
Et pour ce qui est des livres, que donne-t-elle maintenant à ceux qui ne la connurent pas ? Il y a vingt ans je publiai son Grand Jour dans la collection « LâExtrême contemporain » chez Belin. (Martine voulut entrer au comité de Po&sie. Comme elle était invivable, nous préférâmes ne pas courir le risque de la fâcherie). LâÅuvre est brève et faite de reprises comme la main recouvre partiellement la main, un livre reprend et passe les poèmes avec les poèmes du précédent. Clivages (1983), Passages (1985), Celan (1986), Lâamour du nom (1997), Juarroz (2003)⦠et les Eblouissements de Flammarion qui reprend les titres (2003). Chaque poème est bref, strict, articulé en distiques ou strophes resserrées. Poésie gnomique, autobiographique « ésotérique » au sens de ce qui garde le secret. Lyrique ; dâamour, de mort et de célébration. « Et, en dépit des imprécations et des sinistres prophéties, la poésie dâamour devrait encore moins quâune autre être appelée à disparaître aujourdâhui, car à lâépoque de la mort de Dieu, notre illumination la plus accessible est profane »[5]
Michel Deguy
Novembre 2012
[1] Page 38 de lâédition Belin. Voir
[3] Lâamour du nom, p. 253, José Corti 1997..
[4] Ibid, p. 259
[5] Ibid, p. 260
Voir l'article complet