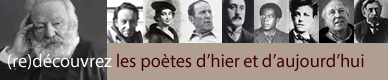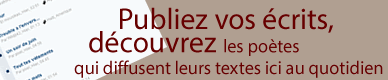par Jacques Sicard
Les maris. Leur vie de petit enfant que le mariage encourage. Petit enfant qui à l’instar de celui dont c’est l’âge ne sait pas bien distinguer entre désir et réalisation du désir, entre imaginaire et réalité. Pour qui le caractère passionné de ses pulsions instinctives a une force magique : le désir de s’affranchir affranchit. A ceux-là, Cassavetes dans Husbands offre un temps incommensurable, leur laisse le temps d’ajouter et d’ajouter encore à la perfection classique de leur infantilisme. Ce qui contrarierait les maîtres du XVIIème siècle qui définissaient le classicisme comme cette construction délibérée d’une langue au-delà de laquelle on ne peut aller. Mais Cassavetes est un pervers se moquant bien de la règle de non-répétition qui préside au sonnet.
Les maris. Enfançons lourds d’années au moins pour chacun quarante fois sonnées, où vont-ils qui, au petit matin quotidien, après moult beuveries, plans-culs, bravades et cris, s’avancent vers nous avec à la bouche un de ces sourires canailles fredonnant à qui veut l’entendre l’avant-dernier couplet, celui détourné, de La Marseillaise :
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos âmes ne seront plus
Ils ne trouveront leurs poussières
Ni leurs coeurs auxquels tout déplut
- ils rentrent à la maison.
Le montreur de temps imaginaire, Cassavetes, seul aura bougé.
Qu’est-ce qu’un temps imaginaire ?
C’est un temps dont l’incommensurabilité est contenue dans l’empan d’une main qui compte les secondes.
Les deux dimensions de l’empan sont réelles. Sans mesure et mesure, en même temps et à même hauteur.
Ca fonctionne comme un double-bind ou double-contrainte. D’où son filigrane de terreur.
Dans ses films, Cassavetes use à l’envie du temps imaginaire. C’est le régime temporel des scènes où les enfançons et les enfantelettes, abusivement hommes et femmes, qui en occupent l’espace, sont comme des vampires surpris par l’aurore.
Voir l'article complet