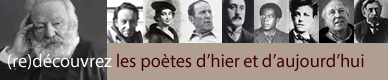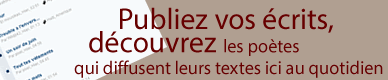Bourreaux de solitude
#1

Posté 26 septembre 2007 - 06:48
Prenons soin de distinguer l'acte poétique de la transmission de récits ou d'arts oratoires qui n'impliqueraient pas une appropriation subjective du matériau verbal. La poésie, nous la voyons comme l'invention d'un je, d'un rapport du je au tu, au nous, etc. Si elle n'était que transmission d'un héritage culturel, il n'y aurait pas d'histoire de la poésie.
Pour spécifier le cadre général de l'approche sérielle, rappelons les grandes lignes de la sémiosphère de Lotman : la structure du dialogue organise les échanges entre cultures de la même façon que les rapports interpersonnels; L'élément dynamique de la poésie, c'est l'échange, la transmission-traduction aboutissant à une reformulation. Nous voyons ce phénomène sur de larges séquences temporelles (l'histoire du sonnet, par exemple) comme sur des segments extrêmement ciblés (la naissance du romantisme). Enfin, à notre époque, les phases d'"écoute" et de "transmission" suivent des chemins multiples, sutr lesquels nous ne nous attarderons pas ici.
Ce qui découle de cette vue lotmanienne, c'est que la poésie est un acte social. Que le poète isolé et qui atteint à la vérité suprême de la poésie est victime d'une illusion post-romantique. Réellement, il n'y a pas de "solitude" poétique. Mais nous devrons encore interroger cette image de solitude qui s'attache au travail poétique, voir s'il n'y a pas quelque faux-semblant à lever pour bien comprendre cette question.
Si la solitude poétique est un mythe, nous devons nous convaincre que la poésie se constitue de façon favorable dans un contexte de forte socialisation. Et, en effet, nous en voyons des sociétés de poésie ! De la Pléiade au groupe surréaliste, en passant aujourd'hui par l'activité considérable d'éditeurs-imprimeurs qui exercent au quotidien, pas seulement sur un plan financier, le risque de la poésie, son existence est définitivement liée à la constitution de "sociétés" qui prennent une forme ou une autre.
Pourtant, le fonctionnement de ces "sociétés" reste à interroger. En leur sein comme entre elles, nous voyons les conflits se multiplier, leur existence même procède du conflit et, fait paradoxal, l'émergence de poètes conséquents paraît étroirement liée à des phénomènes de rejet et de rupture. Le cas le plus remarquable est le surréalisme. Il apparaît aujourd'hui nettement que les figures les plus marquantes de ce courant sont précisément celles qui ont (de gré ou de force) rompu avec le groupe.
En bien des circonstances, le fonctionnement des sociétés poétiques apparaît impropre à permettre l'éclosion du poème. A cela, une première cause possible saute aux yeux : si nous admettons que le poème est invention d'un je, d'un rapport je-tu, nous supposons que ce dire est "en avant", pour reprendre le mot de Rimbaud. Les sociétés poétiques se constituent sur des principes établis, quant à elles. Le clash est inévitable dès lors que la singularisation de ce dire aura excédé le cadre discursif du groupe : c'est ainsi que le Parnasse rejeta deux de ses représentants défectueux ou défaillants, vers 1850 : un certain Paul Verlaine et un dénommé Stéphane Mallarmé.
Les voilà ! Ils se sont retrouvés seuls ! Et l'on n'est pas encore à cette époque moderne où le clash fait événement, permettant d'exister à peu de frais, au sein d'un tissu social donné ! D'autres exemples ont de quoi étonner : le sort que fit la cour de Louis XIV à Racine quand il écrivait Phèdre, Louise Labé, etc. Le passage de Rimbaud a Paris nous laisse soupçonner de semblables difficultés pour le poète à transmettre son art, à lui donner l'existence qu'aujourd'hui on lui accorde à l'excès !
Cet état de conflit permanent, comme un miroir de ce qui se trame au sein même du langage poétique (où tout n'est que conflit ou, selon le mot de Tynianov, distorsion de séries les unes par les autres) a donc de quoi laisser perplexe. Est-il imaginable de sortir de cette production conflictuelle du poème ? si nous admettons aisément la nature double, individuelle et collective, du poème, n'avons-nous d'autre conclusion que de dire, ce qui devienrait lassant à force : "En poésie, c'est toujours la guerre" ?
Je crains qu'il ne faille en accuser la formation intellectuelle des poètes, plutôt qu'un état de nature. Je crains qu'effectivement, cette situation soit la conséquence d'un impensé, d'un mal-pensé, qui est le poème lui-même. Comme acte subjectif. Comme production anthropologique. Et que cette carence éducative ne soit à la source de nombreux malentendus, avec pour conséquences : 1 - une production générale médiocre ; un impact faible de la poésie sur la vie culturelle de l'époque.
Si les conflits de personnes sont si nombreux, si les rivalités, souvent ridicules car elles témoignent d'une conception étroite du domaine poétique, ne tarissent pas, c'est bien qu'on a laissé aux enseignants un territoire sans balises. La poésie est une masse confuse où chacun pioche à sa guise : les uns y jetten des barils d'émotion, les autres des jeux en pagaïe, mille philosophies laxistes du poème peuvent naître sans que jamais soit abordée, dans sa complexité (c'est-à -dire : la multiplicité contradictoire de ses existences) la question du langage poétique.
On en viendrait presque à regretter les vestiges de l'ancienne rhétorique, qui du moins posait une série d'exigences basiques à celui qui prétendait écrire ! Mais la nostalgie n'a rien à faire ici et nous devons simplement nous demander si nous avons les moyens de formuler, de façon adéquate avec l'expérience moderne du poème, une exigence neuve à l'endroit de ceux qui s'aventurent sur cette voie peu sûre.
De Kandinsky à René Char, de Celan à Grosjean, des réponses s'esquissent. Elles sont intransigeantes : "Il y a peu d'hommes, écrit Paul Celan dans une lettre à Hans Bender, c'est pourquoi il y a peu de poèmes". On peut être tenté de balayer d'un revers de main cette violence affirmative. Mais le constat est d'autant plus lourd qu'il engage le principe d'humanité lui-même et qu'il repose sur une évidence simple, gênante peut-être, cruelle en tout cas : l'humanité est rare. Ce qui est inhumain, ce n'est pas la seule barbarie des dictateurs, des fanatiques : c'est l'indifférence de la masse au devenir commun qui se joue, chaque fois, dans des trajectoires individuelles.
C'est pourquoi le principe du groupe, s'il a toujours un moment dynamique au cours duquel les échanges se multiplient et favorisent une création plurielle, connaît non moins inéluctablement un moment régressif, où l'appartenance au sens grégaire, sinon tribal, devient première. Dès lors, le groupe se ferme autour de ses symboles identitaires et la destruction du pseudo-collectif se fait impérative.
#2

Posté 27 septembre 2007 - 06:11
Tout conflit a sa gestion : scission ou concession. Je ne pense pas, comme tu l'écris, que ne soit " jamais abordée dans sa complexité (c'est-à -dire : la multiplicité contradictoire de ses existences) la question du langage poétique. ", mais je pense que dans le domaine de la poésie - comme dans tout autre domaine - , il existe une certaine forme de corruption - altération poétique et fonctionnement institutionnel - : copinages, réseaux, fausses notoriétés, talents créés de toute part, mégalomanie, modes, prestige du poète, récupération et éloges sans fin des petits copains journalistes, carriérisme au dépend d'une poétique libre. La plupart des sociétés littéraires sont aussi policées, lisses, formatées, conformistes, compétitives (concours…) que les plus classiques des sociétés commerciales ou des épiceries ayant pignon sur rue. Il ne suffit que de voir sur le net les poètes actuellement aligner leur CV, leurs moindres prix et déplacements comme autant d'attestations de poétique ! Il s'agit alors de savoir quelle direction prendre : concession ou scission. Et c'est ainsi que naquit la jambe de Rimbaud (que j'adore).
#3

Posté 27 septembre 2007 - 12:35
Jadis, en Russie, s'était constitué l'Oupoiaz, où linguistes, littérateurs et poètes échangeaient librement. Je pense que de telles structures permettent de bénéficier d'un apect qui n'est pas la totalité du fait artistique mais qui n'en est pas moins essentielle : le professionnalisme.
#4

Posté 27 septembre 2007 - 01:41
#5

Posté 27 septembre 2007 - 01:57
#6

Posté 28 septembre 2007 - 04:37
René Char : "Mon métier est un métier de pointe."
Oui, très jolie parole de René Char ramenant ainsi le matériau " mot " et sa fonction, son apprentissage et sa transmission, en un espace social commun à tous les hommes : le travail et sa technologie fine qu'est la poésie. Nécessaire démarcation avec un soi-disant mystère poétique relevant d’entités plus ou moins nébuleuses : du ciel aux ateliers de la terre. Les mains pleines de mots.
Tes articles obligent à réfléchir sur le fait poétique, merci.
#7

Posté 28 septembre 2007 - 01:21
Si la question de l'émotion poétique ne pose pas de difficulté particulière en tant qu'objet conceptuel, il n'en va pas de même pour la question de la réalisation sociale du poème. Elle fluctue, d'une façon impressionnante, non seulement d'une époque à l'autre mais au sein d'une même époque, au coeur d'une même "société poétique" ! La sériographie ne peut ignorer une question si complexe.
Je conviens, ce n'est pas tout à fait comme les maths, Hein…personne n'osera en faire qu'à sa tête, ou compter à sa guise comme il veut, et peu…peu importe le résultat.
Pour moi la question poétique est tout simplement prophétisée par la différence individuelle, et non par l'incorporation poétique d'un société en agonie, et cela peut se vérifier par les spécificités culturelles qui accroissent cette différence, jusqu'à en faire un choc ! Seulement ce n'est pas toujours d'un choc poétique ou culturel dont il est question, puisque, en situation conflictuelle, on a souvent tendance à remplacer vite les mots par les armes !
Libre à qui vaudrait contempler les gouttes d'une pluie torrentielle, mais ne pas voir en la pluie ce que seul le sage peut voir, revient à mon sens à s'occuper, dans un terrain aride, que nul n'espère voir un jour verdir.
#8

Posté 28 septembre 2007 - 01:30
#9

Posté 28 septembre 2007 - 05:37
#10

Posté 28 septembre 2007 - 06:12
#11

Posté 28 septembre 2007 - 06:22
#12

Posté 28 septembre 2007 - 06:34
#13

Posté 28 septembre 2007 - 06:36
#14

Posté 28 septembre 2007 - 06:37
#15

Posté 29 septembre 2007 - 07:07
#16

Posté 29 septembre 2007 - 10:49
Bon dieu je ne serais jamais poete, j'ai bien trop peur de la mort. Enfin, de ce qui m'attend.
#17

Posté 29 septembre 2007 - 11:09
#18

Posté 29 septembre 2007 - 11:27
En fait je me confonds souvent avec ce que je pense. Enfin ca n'a pas de sens de dire ca, je me confonds souvent avec une represensation de ce qui pourrait etre possible.
Vous avez un remede ?
#19

Posté 30 septembre 2007 - 05:45
#20

Posté 05 novembre 2007 - 08:30
René Char
(La bibliothèque est en feu)