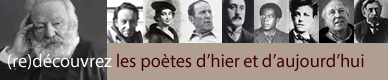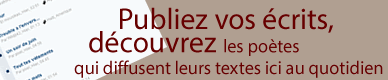@ Thomas : j'adhère à ce qui suit. J'écris pour m'amuser, m'exprimer bien plus que pour chatouiller la beauté littéraire. Mais au final, il est parfois aisé de déstabiliser les puissants qui ne s'encombrent même plus d'arguments puisqu'ils ont le pouvoir et la prétendue légitimité.
Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la bonne blague au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les maîtres, les puissants. En ce sens, Ésope est un précurseur de l'anti-héros, laid, méprisé, sans pouvoir initial, mais qui parvient à se tirer d'affaire par son habileté à déchiffrer les énigmes.
En raison du nombre de fables que cette légende comprenait, celles-ci ont dès lors pu commencer à circuler de façon autonome, à la façon de bons mots qu'on se racontait. Par la suite, des fables antérieures auraient été ré-attribuées à cette source, qui jouait le rôle d'un recueil. Il faut ajouter que, le grec ne possédant pas de terme spécifique pour désigner la fable, le nom d'Ésope a servi de catalyseur, et ce d'autant plus facilement que toute science, toute technique, tout genre littéraire devait chez eux être rattaché à un « inventeur ». Ainsi s'explique, en partie, qu'Ésope soit si vite devenu la figure emblématique de la fable.
Le premier recueil de Fables est dû à Démétrios de Phalère vers 325 av. J.-C.. Le recueil original est perdu. Le recueil que connaissait La Fontaine comprenait 127 fables.
Les fables d'Ésope étaient écrites en prose et sans prétention littéraire. Cela fit dire à Hegel : « La prose commence dans la bouche d'un esclave ; aussi le genre tout entier est prosaïque ». Les fables d'Ésope furent reprises et traduites en latin par Phèdre. Babrias en produisit de nouvelles (IIe siècle av. J.-C.).