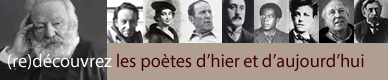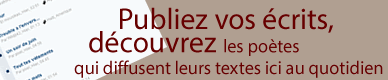Yeux
#2

Posté 05 novembre 2014 - 08:18
Vrai !
Dois-je m'inquiéter ? ;-)
#3

Posté 05 novembre 2014 - 08:50
#4

Posté 05 novembre 2014 - 11:57
Yeux
est difficile à dire
nu.
D'autant qu'on ne pourrait
se les rincer.
#5

Posté 06 novembre 2014 - 09:51
grandiose.
#6

Posté 06 novembre 2014 - 01:27
D'autant qu'on ne pourrait
se les rincer.
Bain d'yeux d'bain d'yeux !!!
#7

Posté 06 novembre 2014 - 02:09
Bain d'yeux d'bain d'yeux !!!
Ou: comment, en général, avoir un verre à l'oeil pour pas trop cher.
#8

Posté 06 novembre 2014 - 09:58
Ne pas confondre
yeux et oeufs.
#9

Posté 13 novembre 2014 - 10:27
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.
Yeux
est difficile à dire
nu.
#10

Posté 13 novembre 2014 - 11:57
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.
#11

Posté 14 novembre 2014 - 12:35
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.
Bain d'yeux d'bain d'yeux !!!
#12

Posté 14 novembre 2014 - 08:16
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.Bain d'yeux d'bain d'yeux !!!
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.
#13

Posté 14 novembre 2014 - 12:35
Yeux
est difficile à dire
nu.
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.
#14

Posté 15 novembre 2014 - 03:56
excellent
#15

Posté 15 novembre 2014 - 05:27
#16

Posté 15 novembre 2014 - 06:50
Yeux
est difficile à dire
nu.Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.
#17

Posté 21 novembre 2014 - 07:40
Yeux
est difficile à dire
nu.
#18

Posté 21 novembre 2014 - 10:10
#19

Posté 21 novembre 2014 - 10:41
J'ai trouvé des yeux dans mon frigo
Mais mon frigo est vide
Et mes yeux sont morts
Du coup j'ai allumé la radio
François Hollande a été assassiné
Par deux yeux et
Les chars entrent dans Paris
#20

Posté 21 novembre 2014 - 10:50
#21

Posté 21 novembre 2014 - 11:03
Place vendôme oui
#22

Posté 21 novembre 2014 - 11:04
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.Bain d'yeux d'bain d'yeux !!!
Les yeux sont les fenêtres de la salle d'eau.
Ne pas confondre
yeux et oeufs.Yeux
est difficile à dire
nu.
#23

Posté 21 novembre 2014 - 11:16
Dans ses yeux
Moi ou elle
Je ne sais pas
Un bar à la con
Pigalle
J'ai repris une bière
Je lui ai payé un verre
Et ses yeux
Tu pourras le dire à tout le monde
Mais tes yeux
Non je ne me souviens pas
De ce bar de Pigalle
Mais de ses yeux oui
Sur les toits
L'amour impossible
L'amour à la Godard
Mon coeur s'attachait à ces yeux
Non c'est con un
Bar à Pigalle
#24

Posté 22 novembre 2014 - 08:57
Dans ses yeux
Moi ou elle
Je ne sais pas
Un bar à la con
Pigalle
J'ai repris une bière
Je lui ai payé un verre
Et ses yeux
Tu pourras le dire à tout le monde
Mais tes yeux
Non je ne me souviens pas
De ce bar de Pigalle
Mais de ses yeux oui
Sur les toits
L'amour impossible
L'amour à la Godard
Mon coeur s'attachait à ces yeux
Non c'est con un
Bar à Pigalle
Ah ! Paris...
#25

Posté 22 novembre 2014 - 09:58
Les dictionnaires sont d’accord pour situer le premier emploi du mot, en français, en 1715, dans le domaine des mathématiques. C’est Varignon, qui dans son Histoire de l’Académie des sciences1, évoque les thèses exposées dans Seriebus infinibus par Bernoulli, dans la continuité de Leibniz. Reste à savoir s’il s’agit de Jean ou de Jacques. Les Bernoulli (ou Bernouilli) sont en effet une famille suisse dont de nombreux savants sont issus. Jacques, qui vécut dans la seconde moitié du XVIIe siècle, développa la théorie et les applications du calcul différentiel et intégral2. Le DBHG précise qu’il a découvert les propriétés des Nombres dits ォ de Bernouilli サ, dans la théorie du développement en séries, et qu’il a posé les fondements de la théorie de la probabilité. Nous verrons les incidences nettement distinctes qu’ont eues ces deux domaines de recherches. Son frère, Jean (qui est son cadet de treize ans, et qui pourtant mourut en 1748, quarante-trois ans après lui), ォ s’occupa également du calcul différentiel et intégral, découvrit le calcul exponentiel et la méthode pour intégrer les fractions rationnelles サ3. Citons encore Nicolas Bernouilli, qui, dans une thèse sur les absents, ォ proposa d’appliquer à cette question de jurisprudence le calcul des probabilités サ4. Daniel Bernouilli, enfin, l’un des fils de Jean, né en 1700 et mort en 1782, ォ cultiva lui aussi le calcul des probabilités, et fut à l’origine des séries trigonométriques par son travail sur le problème des cordes vibrantes サ5. Mais la généalogie des Bernoulli n’est pas seulement illustre : elle montre l’extension de la série dans les mathématiques, par le biais de la chimie et de la statistique. Une étude plus fine, mieux instruite, montrerait les incidences exactes qu’ont eues ces différentes recherches (celles de la famille Bernouilli sur le développement des fonctions en série et sur le calcul des probabilités ; celles de Joseph Fourier sur la propagation de la chaleur) sur le sémantisme général de série en français.
1 P. 203. La référence est donnée par le Trésor de la langue française, à l’article ォ série サ.
2 In, Dictionnaire biographique, géographique et historique, art. ォ Bernouilli サ .
3 ibid.
4 ibid.
5 ibid.
#26

Posté 22 novembre 2014 - 10:44
J'habite Mezieux.
un regard de provincial...
#27

Posté 22 novembre 2014 - 12:28
L’expression musique sérielle est apparue en France dans l’immédiat après-guerre. Il semble que ce soit René Leibowitz, qui enseignait à l’époque la méthode de composition de Schoenberg; qui l’ait introduite dans le lexique. Le sérialisme de l’école de Darmtadt est plus radical que ne l’est celui de Schoenberg. La méthode de Schoenberg touchait uniquement le système des hauteurs : le compositeur était tenu d’employer les douze notes de la gamme selon une même ordonnance, aucune note ne devant être répétée avant que les onze autres ne soient passées. Principe moins mécaniste qu’il n’y paraît de prime abord puisque la série, qui se transpose sur les douze demi-tons de la gamme chromatique, connait en outre trois transformations, héritées du canon polyphonique tonal. L’école néo-sérielle (Boulez, Barraqué en France ; Stockhausen en Allemagne ; Nono, Maderna, Berio en Italie ; Nunes au Portugal) s’est d’abord revendiquée de Webern, élève de Shoenberg, à qui l’on doit les premières tentatives d’extension du principe sériel : se revendiquer de Webern revenait, pour ces compositeurs,, à redendiquer une tentative d’adéquation de toutes les composantes du son -- la durée, le timbre, l’intensité -- avec la ォ méthode sérielle サ qui, jusqu’alors, ne touchait que les hauteurs. A la fin des années cinquante, Pierre Boulez prononce la série de conférences qui feront la matière de Penser la musique aujourd’hui, où est exposé le ォ système général sériel サ. La série, alors, devient le ォ germe d’une hiérarchisation fondée sur les propriétés psycho-physiologiques acoustiques, douée d’une plus ou moins grande sélectivité, en vue d’organiser un ensemble FINI de possibilités créatrices liées entre elles par des affinités prédominantes par rapport à un caractère donné サ. On reviendra sur cette définition. Le terme de série en musique est moins employé aujourd’hui qu’il ne l’a été. En termes d’écoles, on peut dire que l’école spectrale (Harvey, Grisey, Dufour, Murail) a succédé à l’école sérielle. Mais la notion a été au coeur d’une transformation radicale de notre écoute musicale. Par la mise à égalité des quatre composantes du ォ fait sonore サ (hauteur, durée, timbre, intensité), elle a ouvert la voie aux recherhes contemporaines sur le timbre. Elle reste une question posée à la structure et au système.
#28

Posté 23 novembre 2014 - 09:47
montés aux murs comme des
vitres.
#29

Posté 23 novembre 2014 - 10:58
Yeux miroirs
montés aux murs comme des
vitres.
#30

Posté 23 novembre 2014 - 11:33
Lexpression musique sérielle est apparue en France dans limmédiat après-guerre. Il semble que ce soit René Leibowitz, qui enseignait à lépoque la méthode de composition de Schoenberg; qui lait introduite dans le lexique. Le sérialisme de lécole de Darmtadt est plus radical que ne lest celui de Schoenberg. La méthode de Schoenberg touchait uniquement le système des hauteurs : le compositeur était tenu demployer les douze notes de la gamme selon une même ordonnance, aucune note ne devant être répétée avant que les onze autres ne soient passées. Principe moins mécaniste quil ny paraît de prime abord puisque la série, qui se transpose sur les douze demi-tons de la gamme chromatique, connait en outre trois transformations, héritées du canon polyphonique tonal. Lécole néo-sérielle (Boulez, Barraqué en France ; Stockhausen en Allemagne ; Nono, Maderna, Berio en Italie ; Nunes au Portugal) sest dabord revendiquée de Webern, élève de Shoenberg, à qui lon doit les premières tentatives dextension du principe sériel : se revendiquer de Webern revenait, pour ces compositeurs,, à redendiquer une tentative dadéquation de toutes les composantes du son -- la durée, le timbre, lintensité -- avec la méthode sérielle qui, jusqualors, ne touchait que les hauteurs. A la fin des années cinquante, Pierre Boulez prononce la série de conférences qui feront la matière de Penser la musique aujourdhui, où est exposé le système général sériel . La série, alors, devient le germe dune hiérarchisation fondée sur les propriétés psycho-physiologiques acoustiques, douée dune plus ou moins grande sélectivité, en vue dorganiser un ensemble FINI de possibilités créatrices liées entre elles par des affinités prédominantes par rapport à un caractère donné . On reviendra sur cette définition. Le terme de série en musique est moins employé aujourdhui quil ne la été. En termes décoles, on peut dire que lécole spectrale (Harvey, Grisey, Dufour, Murail) a succédé à lécole sérielle. Mais la notion a été au coeur dune transformation radicale de notre écoute musicale. Par la mise à égalité des quatre composantes du fait sonore (hauteur, durée, timbre, intensité), elle a ouvert la voie aux recherhes contemporaines sur le timbre. Elle reste une question posée à la structure et au système.
Ah ! Paris...