Certaines phrases de Rimbaud sont essentielles. Ainsi, celle-ci : « Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? »(« Les Illuminations », « Enfance », V, explicit ). La question, en apparence, reste en suspens, mais laisse la possibilité à ce « soupirail » d’exister : car cette phrase éclaire, rétrospectivement, le texte, comme elle éclaire notre vie.
Cette phrase évoque la mission tacite qui est celle de tout texte littéraire, qui justifie que l’on tienne une plume : cette « apparence de soupirail », bien que la phrase soit au conditionnel et que rien ne nous permette d’avoir la certitude de l’existence de ce soupirail, il n’en reste pas moins qu’il est évoqué, espéré peut-être, comme on évoque l’amour, aux pires instants de solitude, et par le seul fait qu’il apparaît ici, il sous-entend un lien avec l’extérieur de cet endroit « très loin sous terre », de ce « salon souterrain » où le poète prétend se trouver. Cette « apparence de soupirail » suffit à susciter l’infime lumière, (contenue dans le verbe « blêmirait »), l’infime espérance, l’infime attente dont, à tout moment de notre vie, nous avons cruellement besoin.
En fait, si l'on analyse les cinq textes qui constituent « Enfance » (qui n'ont rien de textes autobiographiques :-- tout comme l’ensemble des textes d’ « Une saison enfer », qui n’est, sans doute, qu’une gigantesque antiphrase -- force nous est de constater qu' il s’agit d’une vie métaphorique, d’une vie réinventée) on prend conscience qu'ils décrivent, tous les cinq, un monde irrespirable, dont témoignent les dernières phrases de chaque fragment : « Quel ennui, l'heure du « cher corps » et du « cher coeur » (I), « Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes », (II), « Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse » (III) » ,« Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant »(IV). On voit à quel point l’univers décrit ici est inacceptable, à quel point il faut s’en libérer. De nombreux textes de Rimbaud, tout comme « Enfance » , (songeons au « Bateau ivre ») sont des appels à une révolte, à une libération.
C’est pourquoi il faut, sans doute, interpréter la phrase « Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? » comme une antiphrase, qui peut se résumer par la formulation négative : « Pourquoi une apparence de soupirail ne blêmirait-elle pas au coin de la voûte ? »
Comme tous les poètes, d’une certaine façon, Rimbaud naît, en tant que poète, en s’opposant à ses prédécesseurs : loin de l’univers idéalisé de l’enfance évoqué par Baudelaire (« le vert paradis des amours enfantines »), « Enfance » est une suite de textes qui dénonce la vie impossible à vivre, la vie interdite (« Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse » (III)). Là où Baudelaire dit "paradis", Rimbaud parle d' "enfer".
Rimbaud évoque, en réalité, un monde clos, un monde captif, contre lequel il souhaite que le lecteur se révolte, afin qu'il ne vive, qu'il n'écrive que pour qu'une «une apparence de soupirail » blêmisse, enfin, « au coin de la voûte ». Si l’étymologie du mot « enfant » est « celui qui ne parle pas » (« « Je suis le maître du silence », dit le locuteur, – le « silence », ici, est à interpréter comme un cloisonnement, un enfermement), accéder au soupirail revient à accéder à l’ouverture sur le monde, accéder à la parole.
24/12/17
Cette phrase évoque la mission tacite qui est celle de tout texte littéraire, qui justifie que l’on tienne une plume : cette « apparence de soupirail », bien que la phrase soit au conditionnel et que rien ne nous permette d’avoir la certitude de l’existence de ce soupirail, il n’en reste pas moins qu’il est évoqué, espéré peut-être, comme on évoque l’amour, aux pires instants de solitude, et par le seul fait qu’il apparaît ici, il sous-entend un lien avec l’extérieur de cet endroit « très loin sous terre », de ce « salon souterrain » où le poète prétend se trouver. Cette « apparence de soupirail » suffit à susciter l’infime lumière, (contenue dans le verbe « blêmirait »), l’infime espérance, l’infime attente dont, à tout moment de notre vie, nous avons cruellement besoin.
En fait, si l'on analyse les cinq textes qui constituent « Enfance » (qui n'ont rien de textes autobiographiques :-- tout comme l’ensemble des textes d’ « Une saison enfer », qui n’est, sans doute, qu’une gigantesque antiphrase -- force nous est de constater qu' il s’agit d’une vie métaphorique, d’une vie réinventée) on prend conscience qu'ils décrivent, tous les cinq, un monde irrespirable, dont témoignent les dernières phrases de chaque fragment : « Quel ennui, l'heure du « cher corps » et du « cher coeur » (I), « Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes », (II), « Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse » (III) » ,« Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant »(IV). On voit à quel point l’univers décrit ici est inacceptable, à quel point il faut s’en libérer. De nombreux textes de Rimbaud, tout comme « Enfance » , (songeons au « Bateau ivre ») sont des appels à une révolte, à une libération.
C’est pourquoi il faut, sans doute, interpréter la phrase « Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ? » comme une antiphrase, qui peut se résumer par la formulation négative : « Pourquoi une apparence de soupirail ne blêmirait-elle pas au coin de la voûte ? »
Comme tous les poètes, d’une certaine façon, Rimbaud naît, en tant que poète, en s’opposant à ses prédécesseurs : loin de l’univers idéalisé de l’enfance évoqué par Baudelaire (« le vert paradis des amours enfantines »), « Enfance » est une suite de textes qui dénonce la vie impossible à vivre, la vie interdite (« Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse » (III)). Là où Baudelaire dit "paradis", Rimbaud parle d' "enfer".
Rimbaud évoque, en réalité, un monde clos, un monde captif, contre lequel il souhaite que le lecteur se révolte, afin qu'il ne vive, qu'il n'écrive que pour qu'une «une apparence de soupirail » blêmisse, enfin, « au coin de la voûte ». Si l’étymologie du mot « enfant » est « celui qui ne parle pas » (« « Je suis le maître du silence », dit le locuteur, – le « silence », ici, est à interpréter comme un cloisonnement, un enfermement), accéder au soupirail revient à accéder à l’ouverture sur le monde, accéder à la parole.
24/12/17
- Loup-de-lune aime ceci


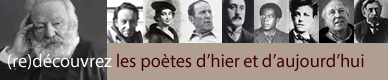
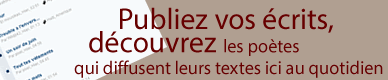
 Créer un thème personnalisé
Créer un thème personnalisé

