Mémoire: L'Oulipo, Simon Buchou
Posté par Cyraknow,
29 octobre 2008
·
2 840 visite(s)
Oulipo, mémoire de Simon Buchou
Je suis sûre que Simon, qui a été très encourageant lorsque je manifestai un grand intérêt pour ce style méconnu d'écriture, ne m'en voudra pas de poster ici son travail magnifique.
BUCHOU Simon
L’OuLiPo :
Histoire d’une Contrainte
Nous souhaitons adresser nos remerciements
les plus sincères :
A Paul Fournel, président de l’Oulipo,
pour avoir accepté de répondre très aimablement à quelques questions,
A Patrick Charrière,
pour nous avoir fait connaître
et expérimenter diverses contraintes Oulipiennes,
lors de délicieux ateliers d’écriture,
A Christophe Charneau, étudiant en chinois,
pour nous avoir fait découvrir un poète de l’empire du milieu
plagiaire par anticipation de l’Oulipo,
dont un poème figurera dans ce dossier,
A tous les oulipiens
pour leurs travaux passionnants,
qu’ils soient vivants ou “excusés aux réunions pour cause de décès“,
Ainsi qu’à ceux, malencontreusement oubliés,
qui nous auront apporté ne serait-ce qu’une aide infime.
“Il n'y a pas d'écriture informe.
Chaque texte a une forme.
Le plus souvent, elle est inconsciente :
c'est la forme à la mode, celle que l'on a appris à l'école, celle qui plaît aux lecteurs, celle qui rapporte de l'argent aux éditeurs.
C'est le roman en ce moment, ça a été la poésie jadis, la tragédie auparavant...
Appliquer la contrainte et réfléchir aux problèmes de forme, c'est prendre conscience de cet état de fait.
C'est aussi le moyen de ruser avec les forces inconscientes individuelles et les formes collectives consensuelles.
C'est le chemin vers une nouvelle façon d'écrire et donc de lire. “
Paul Fournel
I INTRODUCTION. P.6
a) Qu’est ce que l’Oulipo ? P.6
 Ce que l’Oulipo n’est pas. P.8
Ce que l’Oulipo n’est pas. P.8
II PETITE HISTOIRE DE L’OULIPO. P.11
a) Création et débuts de l’Oulipo P.11
 L’Oulipo aujourd’hui P.12
L’Oulipo aujourd’hui P.12
c) Les œuvres classiques de l’Oulipo P.14
III L’OULIPO AVANT L’OULIPO. P.19
a) Les contraintes du passé P.19
- Le sonnet
- L’alexandrin
- L’acrostiche
- Le lipogramme
- Le palindrome
 Les Plagiaires par anticipation p.25
Les Plagiaires par anticipation p.25
IV LA LITTERATURE POTTENTIELLE. P.28
a) Echantillons de différentes contraintes (synthoulipisme) P.28
- La Littérature combinatoire
- S+7
- La littérature définitionnelle
- L’arbre à théâtre (littérature arborescente)
- La morale élémentaire
- L’alphabet du prisonnier
- Un beau présent
V LE SENS DE LA DEMARCHE OULIPIENNE. P.35
a) L’Oulipo et l’esthétique P.35
 Le paradoxe Oulipien : Atteindre la liberté littéraire grâce
Le paradoxe Oulipien : Atteindre la liberté littéraire grâce
à la contrainte P.38
Appendice P.40
Interview intégrale de Paul Fournel P.40
Bibliographie et sources diverses P.42
I
INTRODUCTION
“Oulipiens : Rats qui ont à construire le labyrinthe
Dont ils se proposent de sortir“
Les Oulipiens
a) Qu’est ce que l’Oulipo ?
“Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est ce que Ou ? Qu’est ce que Li ? Qu’est ce que Po ?
Ou, c’est Ouvroir, un atelier où l’on œuvre. Pour fabriquer quoi ? De la Li.
Li, c’est la littérature, ce qu’on lit et que l’on rature. Quelle sorte de Li ? De la Lipo.
Po signifie potentielle. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la fin des temps, en quantité énormes, infinies, pour toutes fins pratiques. “
L’Ouvroir de Littérature Potentiel est un groupe d’écrivains et de mathématiciens dont la démarche se divise en deux catégories : l’anoulipisme et le synthoulipisme.
L’anoulipisme consiste en l’analyse des œuvres du passé pour y déceler des contraintes (parfois inconscientes) éventuelles. Cette tendance analytique à donc pour but de rechercher les plagiaires par anticipation de l’Oulipo (cf. partie correspondante) comme les Grands Rhétoriqueurs entre autre.
Une partie de ce travail sera consacrée aux résultats de cette démarche d’analyse.
Le synthoulipisme constitue le but premier de l’Oulipo à savoir l’invention de contraintes pour obtenir des matrices littéraires potentielle. François Le Lionnais, premier président de l’Ouvroir, déclare au sujet de la tendance synthétique : «Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies, inconnues de nos prédécesseurs ». Sans aucuns doutes ce courant synthétique est le plus actif et le plus spectaculaire des deux, on lui doit entre autre la « méthode S+7 » mise au point par Pierre Lescure dés 1961, la littérature combinatoire, qui permit à Raymond Queneau d’écrire Cent Mille Milliards de Poèmes en dix pages, les poèmes booléens (basé sur la théorie mathématique des ensembles) et bien d’autres… Dans une partie de ce mémoire nous nous pencherons sur certaines contraintes issues du synthoulipisme.
Dans le premier manifeste de l’Oulipo, le Président des premiers siècles oulipiens (l’Ouvroir aime a considérer un an d’activité comme un siècle), François Le Lionnais, déclare : “En résumé l’anoulipisme est voué à la découverte, le synthoulipisme à l’invention. De l’un à l’autre existent mains subtils passages“.
L’utilisation de contraintes dans l’écriture n’est pas nouvelle (c’est la raison d’être de l’anoulipisme). En effet, prenons comme exemple la Tragédie classique qui répond à des contraintes de formes et de contenu (règle des trois unités), la poésie avec tout son attirail de forme fixe, de rimes, etc.… Bien sur la contrainte absolue reste la langue elle-même avec le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison.
A la question « comment voyez-vous la contrainte dans l’écriture ? », Paul Fournel, président de l’Ouvroir, nous a répondu l’épigraphe donné pour ce devoir, que nous citerons à nouveaux ici : “Il n’y a pas d’écriture informe. Chaque texte a une forme. Le plus souvent, elle est inconsciente : c’est la forme à la mode, celle que l’on a appris à l’école, celle qui plait aux lecteurs, celle qui rapporte de l’argent aux éditeurs […] “.
Dés lors, la question que pose l’Oulipo est “doit-on s’en tenir aux recettes connues et refuser obstinément d’imaginer de nouvelles formules ?“.
Certaines personnes, qui pratiquent le contentement avec ferveur répondent que oui ; Le Lionnais les appelaient : “les partisans de l’immobilisme“… Les oulipiens quant à eux pensent évidement que non, de même que les Grands Rhétoriqueurs à leur époque, à propos desquelles Paul Fournel dit ceci : “les poètes du XVIe sont joueurs, graves et parfaits. Ce sont des inventeurs“. Est-il nécessaire de rappeler l’importance de ces poètes sur la langue française, tout juste naissante dans sa forme moderne ? Qui oserait remettre en cause l’aspect littéraire de ces versificateurs ?
Un raisonnement analogue est à fournir vis-à-vis des Oulipiens. Ce sont aussi des joueurs, graves et parfaits, des inventeurs, des alchimistes du langage et des magiciens de la littérature.
 Ce que l’Oulipo n’est pas.
Ce que l’Oulipo n’est pas.
“1. Ce n’est pas un mouvement littéraire.
2. Ce n’est pas un séminaire scientifique.
3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire“.
“1. Ce n’est pas un mouvement littéraire “. Ces paroles furent prononcées lors d’une conférence à l’institut Henri Poincaré par un porte-parole de l’Ouvroir. Il est important d’épurer ce point parce que nombreux sont les articles (encyclopédiques ou journalistiques) ou les personnes (professorat ou autre) qui n’hésitent pas à qualifier l’Oulipo de mouvement littéraire.
Qu’est ce qu’un mouvement littéraire ? C’est une question qui est nécessaire pour expliquer pourquoi l’Oulipo ne se revendique pas comme tel.
Un mouvement littéraire répond à des exigences esthétiques, culturelles, historiques et parfois philosophiques.
Prenons le cas du Romantisme. Ce mouvement était opposé à une esthétique classique, il refusait les thèses rationalistes des lumières. Il privilégiait l’expression personnelle en reculant devant les règles formelles et les conventions. Le Romantisme est indissociable des transformations contemporaines qui eurent lieu : transformations sociales et économiques (industrialisation), transformations politiques (Révolution Française et éveils nationaux). Il fut marqué par les thèses de Rousseau, de Lessing et Herder, du système de Fichte et de Schelling.
L’Oulipo n’est en rien assimilable à un courant ou mouvement littéraire comme le Romantisme ou le Surréalisme. Il ne prétend pas défendre une “esthétique orthodoxe“ disait Paul Fournel, il n’en revendique aucune (esthétique), cela ne veut pas dire qu’il n’en produise pas (nous verrons cela dans la dernière partie). Il n’est pas né suite à quelques bouleversements historiques, économiques, sociaux ou autres en tant que réaction.
L’Oulipo n’est tout bonnement qu’un groupe (cette idée n’est en rien réductrice) se livrant à diverses activités ou expérience (c’est aussi un explorateur du langage, cf. dernière partie) littéraire, ce ayant déjà était expliqué il serait vain de revenir là-dessus. Parler de secte serait mal à propos, étant donné la signification littérale du mot secte, en grec « haeresias » ou hérésie (hérésie à quoi ?) ; mais l’idée est là, “ Ce n’est pas un mouvement littéraire“.
“2. Ce n’est pas un séminaire scientifique“. L’idée peut paraître extravagante ou apprêtée. Mais considérant la prédilection de l’Oulipo pour les mathématiques cela peut être en effet troublant.
Pour comprendre cela il faut simplement appréhender quelle est la place des mathématiques dans l’Ouvroir ; des noms comme François le Lionnais (auteur d’une encyclopédie sur les mathématiques) et Claude Berge (sorcier de la théorie des graphes) font honneur à cette discipline au sein de l’Oulipo.
Une partie traitera plus particulièrement du sujet, mais disons simplement que les oulipiens ont transformés ou utilisés des concepts mathématiques pour les transcrire ou représentés en produit littéraire. Cette science est donc présente dans les activités de ce groupe pour en servir l’aspect littéraire. De là naquirent les contraintes de littérature combinatoire, de poème booléens, de sonnets irrationnels et de bien d’autre. Cet aspect de la synthèse oulipienne est nommé synthoulipisme périmathématique. Comme l’acronyme OU_LI_PO l’indique ce groupe est avant tout esclave de la littérature donc : “ Ce n’est pas un séminaire scientifique “.
“3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire“. On pourrait, en toute ignorance, dire que la productivité oulipienne se résume au hasard dû à l’utilisation de la contrainte.
Opposons à cela une phrase de Raymond Queneau : “il n’y a de littérature que volontaire“. Contrairement aux surréalistes, les oulipiens n’exploitent pas cet aspect du hasard, comme par exemple la pratique du cadavre exquis.
Mais la littérature aléatoire est aussi une œuvre laissant une grande place au choix du lecteur et c’est plus à ce titre que l’on pourrait penser cela de l’Oulipo.
Prenons donc un exemple, à savoir, l’histoire des trois alertes petits pois : un conte à votre façon de Queneau (voir ci-après le graphe et le conte). Le principe est simple : un carré divisé en vingt et une cases, dans chaque cases le fragment d’une histoire, à la fin de ce fragment le lecteur est invité à choisir comment se poursuivra l’histoire en choisissant un renvoi vers une autre case déterminé par l’auteur ainsi de suite jusqu’à la fin de l’histoire.
Cette œuvre est elle aléatoire parce qu’elle laisse un choix relatif au lecteur ? Le lecteur n’a véritablement aucun choix ; c’est en réalité le graphe (cette notion sera abordée plus en détails dans les sous parties « littérature combinatoire » et « littérature arborescente ») qui décide pour lui, le graphe étant façonné par l’auteur. Chaque choix que le lecteur pourrait faire est déjà potentiellement fait par un schéma mathématique. Il en va de même pour les cent mille milliard de poèmes et autre œuvres prétendument aléatoires. “ Ce n’est pas de la littérature aléatoire“.
1. Désirez-vous connaître l’histoire des trois alertes petits pois ?
a. si oui, passez à 4
b. si non, passez à 2
2. Préférez-vous celle des trois minces grands échalas ?
a. si oui, passez à 16
b. si non, passez à 3
3. Préférez-vous celle des trois moyens médiocres arbustes ?
a. si oui, passez à 17
b. si non, passez à 21
4. Il y avait une fois trois petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur cosse.
Leur visage bien rond respirait par les trous de leurs narines et l’on entendait leur ronflement
doux et harmonieux.
a. si vous préférez une autre description, passez à 9
b. si celle-ci vous convient, passez à 5
5. Ils ne rêvaient pas. Ces petits êtres en effet ne rêvent jamais.
a. si vous préférez qu’ils rêvent, passez à 6
b. sinon, passez à 7
6. Ils rêvaient. Ces petits êtres en effet rêvent toujours et leurs nuits sécrètent des songes
charmants.
a. si vous désirez connaître ces songes passez à 11
b. si vous n’y tenez pas, vous passez à 7
7. Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes chaussettes et ils portaient au lit des gants
de velours noir.
a. si vous préférez des gants d’une autre couleur passez à 8
b. si cette couleur vous convient, passez à 10.
8. Ils portaient au lit des gants de velours bleu.
a. si vous préférez des gants d’une autre couleur, passez à 7
b. si cette couleur vous convient, passez à 10
9. Il y avait une fois trois petits pois qui roulaient leur bosse sur les grands chemins. Le soir
venu, fatigués et las, ils s’endormirent très rapidement.
a. si vous désirez connaître la suite, passez à 5
b. si non, passez à 21
10. Tous les trois faisaient le même rêve, ils s’aimaient en effet tendrement et, en bons fiers
trumeaux, songeaient toujours semblablement.
a. si vous désirez connaître leur rêve, passez à 11
b. si non, passez à 12
11. Ils rêvaient qu’ils allaient chercher leur soupe à la cantine populaire et qu’en ouvrant leur
gamelle ils découvraient que c’était de la soupe d’ers. D’horreur, ils se réveillaient.
a. si vous voulez savoir pourquoi ils s’éveillent d’horreur, consultez le Larousse au mot
«ers» et n’en parlons plus
b. si vous jugez inutile d’approfondir la question, passez à 12
12. Opopoï ! S’écrient-ils en ouvrant les yeux. Opopoï ! Quel songe avons-nous enfanté là !
Mauvais présage, dit le premier. Oui-da, dit le second, c’est bien vrai, me voilà triste. Ne
vous troublez pas ainsi, dit le troisième qui était le plus futé, il ne s’agit pas de s’émouvoir,
mais de comprendre, bref je m’en vais vous analyser ça.
a. si vous désirez connaître tout de suite l’interprétation de ce songe, passez à 15
b. si vous souhaitez au contraire connaître les réactions des deux autres, passez à 13
13. Tu nous la bailles belle, dit le premier. Depuis quand sais-tu analyser les songes ? Oui,
depuis quand sais-tu analyser les songes ? Oui, depuis quand ? Ajouta le second.
a. si vous désirez aussi savoir depuis quand, passez à 14
b. si non, passez à 14 tout de même, car vous ne le saurez pas plus
14. Depuis quand ? S’écria le troisième. Est-ce que je sais moi ! Le fait est que je pratique la
chose. Vous allez voir !
a. si vous voulez vous aussi voir, passez à 15
b. si non, passez également à 15, car vous ne verrez rien.
15. Eh bien ! Voyons, dirent ses frères. Votre ironie ne me plaît pas, répliqua l’autre, et vous ne
saurez rien. D’ailleurs, au cours de cette conversation d’un ton assez vif, votre sentiment
d’horreur ne s’est-il pas estompé ? Effacé même ? Alors quoi bon remuer le bourbier de votre
inconscient de papilionacées ? Allons plutôt nous laver à la fontaine et saluer ce gai matin
dans l’hygiène et la sainte euphorie ! Aussitôt dit, aussitôt fait : les voilà qui se glissent hors
de leur cosse, se laissent doucement rouler sur le sol et puis au petit trot gagnent
joyeusement le théâtre de leurs ablutions.
a. si vous désirez savoir ce qui se passe sur le théâtre de leurs ablutions, passez à 16
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
16. Trois grands échalas les regardaient faire.
a. si les trois échalas vous déplaisent, passez à 21
b. s’ils vous conviennent, passez à 18
17. Trois moyens médiocres arbustes les regardaient faire.
a. si les trois moyens médiocres arbustes vous déplaisent, passez à 21
b. s’ils vous conviennent, passez à 18
18. Se voyant ainsi zyeutés, les trois alertes petits pois qui étaient fort pudiques s’ensauvèrent.
a. si vous désirez savoir ce qu’ils firent ensuite, passez à 19
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
19. Ils coururent bien fort pour regagner leur cosse et, refermant celle-ci derrière eux, s’y
endormirent de nouveau.
a. si vous désirez connaître la suite, passez à 20
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
20. Il n’y a pas de suite le conte est terminé.
21. Dans ce cas, le conte est également terminé.
II
PETITE HISTOIRE DE L’OULIPO
“Jean Queval intervint pour demander
Si l’on est pour les fous littéraires.
A cette question délicate, F. Le Lionnais répondit fort subtilement :
-Nous ne sommes pas contre mais la vocation littéraire
nous intéresse avant tout“.
Compte rendu de la réunion du 13 février 1961
a) Création de l’Oulipo.
“Quand j’ai rencontré Le Lionnais, qui est un ami, il m’a proposé de faire une sorte de groupe de recherche de littérature expérimentale“ déclara Raymond Queneau. C’est donc cet écrivain et ce mathématicien qui fondèrent l’Oulipo en 1960. Enfin… ils fondèrent le SLE, Séminaire de Littérature Expérimentale. C’est en fait un mois plus tard qu’il prit le nom d’Oulipo ou plutôt d’Olipo. L’Oulipo comme nous l’entendons, naquis ou fit acte de son nom actuel grâce au secrétaire général particulier du Vice-Curateur Baron du Collège de Pataphysique qui suggéra d’ajouter le « u » d’ouvroir pour l’équilibre de l’acronyme. Le Lionnais fut le premier président de l’Ouvroir.
Les oulipiens accordèrent leurs soins à la HLE ou Histoire de Littératures Expérimentales qui aujourd’hui porte le nom d’anoulipisme : la recherche des plagiaires par anticipation de l’Oulipo. Mais comme le montre l’épigraphe de cette partie le montre : “ la vocation littéraire nous intéresse avant tout“, la recherche et l’exploration du langage demeuraient le but premier. L’Oulipo commença à rechercher la potentialité dans la littérature qui était et est à faire.
Même mort on reste oulipien. De ce fait l’Oulipo compte un certain nombre « d’esclaves » parfois excusés aux réunions pour cause de décès, d’après l’expression oulipienne, qui sont :
Noël Arnaud, Valérie Beaudouin, Marcel Bénabou, Jacques Bens, Claude Berge, André Blavier, Paul Braffort, Italo Calvino, François Caradec, Bernard Cerquiglini, Ross Chambers, Stanley Chapman, Marcel Duchamp, Jacques Duchateau, Luc Étienne, Frédéric Forte, Paul Fournel, Anne F. Garréta, Michelle Grangaud, Jacques Jouet, Latis, François Le Lionnais, Hervé Le Tellier, Jean Lescure, Harry Mathews, Michèle Métail, Ian Monk, Oskar Pastior, Georges Perec, Raymond Queneau, Jean Queval, Pierre Rosenstiehl, Jacques Roubaud, Olivier Salon, Albert-Marie Schmidt.
Le second président fut Noël Arnaud et aujourd’hui c’est donc Paul Fournel qui en assume la tâche.
 L’Ouvroir de Littérature Potentielle aujourd’hui.
L’Ouvroir de Littérature Potentielle aujourd’hui.
En lui demandant en quoi consistait son rôle de Président, Paul Fournel a répondu par courrier électronique : « Mon travail de Président consiste à me comporter comme les autres membres !
En plus, et en complicité avec notre Secrétaire Provisoirement Définitif, Marcel Bénabou, et la trésorière, je m’occupe de la partie administrative de la vie du groupe : signature des contrats avec les éditeurs, avec les programmateurs, papiers administratifs divers. C’est également au Président que revient la charge de rédiger les préfaces aux volumes collectifs et autres présentations ici ou là. Rien de spectaculaire ».
Paul Fournel, actuel président de l’Ouvroir de Littérature Potentielle.
Paul Fournel s’explique sur la façon dont sont recrutés les membres de l’Ouvroir et sur son enrôlement par Raymond Queneau : «Nous recrutons par cooptation. Nous repérons des jeunes écrivains ou mathématiciens qui nous intéressent. Nous les lisons, nous les invitons à déjeuner et ensuite nous les adoptons – s’ils sont d’accord bien sûr et si nous sommes unanimes. J’ai été recruté comme esclave à l’Oulipo en 1971 par Raymond Queneau sur qui j’avais écrit mon mémoire de Maîtrise et à qui j’avais donné mon premier manuscrit de fiction. Je suis allé rendre hommage au Président Le Lionnais qui était mon voisin et je me suis mis au travail. A quelque temps de là je suis devenu Secrétaire Provisoirement Définitif puis plus tard Président ».
Précisons qu’il ne faut jamais demander à faire partie de l’Oulipo sauf si vous ne voulez pas en faire partie.
Une fois par mois, dans un théâtre à Paris, sont organisés les jeudis de l’Oulipo. C’est un moment de lectures publiques la plus part du temps inédites.
De même, une réunion est organisée tous les mois, où les oulipiens se retrouvent pour dîner ou déjeuner, une partie de la réunion porte sur la création, un oulipien au moins apporte un travail portant soit sur une nouvelle contrainte soit sur une déjà existante.
Parfois, ces créations sont publiées dans « la bibliothèque oulipienne », un opuscule tiré à cent cinquante exemplaires qui échappent aux règles du commerce du livre.
Paul Fournel expose à propos de ces réunions : “ Les réunions sont mensuelles depuis l’origine. Elles sont réservées aux membres et aux éventuels invités d’honneur. En général nous sommes entre 8 et 12. L’ordre du jour comporte la rubrique création qui doit être emplie“.
L’Oulipo fait partie d’une série d’OuXpo.
Il existe en effet une longue liste d’Ouvroirs qui exploitent le concept de potentialité dans leur domaine respectifs. L’Oupeinpo se charge de la peinture, L’Oulipopo est l’Ouvroir de Littérature Policière potentielle, l’Oubapo œuvre dans la bande dessinée, l’Oumupo potentialise la musique, l’Ou’inpo travail dans l’informatique.
Il en existe pour le cinéma, l’histoire, la cuisine, l’architecture, la géographie et bien d’autres disciplines.
c) Les œuvres classiques de l’Oulipo.
Raymond Queneau
Commençons par le commencement. La première œuvre “marquante“ ou devenue classique de l’Oulipo est bien évidement les Cent Mille Milliards de Poèmes de Raymond Queneau, publiée en 1961. C’est là un livre qui exploite la conception de Littérature Potentielle de façon absolue. Dix sonnets (donc de quatorze vers) sont donnés, sur dix pages, chaque vers est inscrit sur une languette qui étant soulevée, laisse apparaître le vers du sonnet suivant, ce sur chaque vers et sur chaque page. Nous avons donc potentiellement 1014 (100 000 000 000 000) poèmes, soit cent mille milliards (10 étant le nombre de sonnet et l’exposant 14 le nombre de vers de chaque sonnets), voir les images ci-après.
Cette forme de poésie est dites exponentielle parce que cette méthode s’obtient avec soit n un nombre de vers (14 pour le sonnet) obéissant à la fonction exponentielle 10n , mais ce n’est qu’un détail lexicographique mathématique. Pour souligner la valeur hautement potentielle de son recueil de poème, Queneau déclare : “En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 seconde pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d’un million de siècle de lecture, et en lisant toute la journée 365 jours par an, pour 190 258 751 années plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autre détails“.
Ce livre est aussi l’acte de naissance de la littérature combinatoire.
Plan des Cents Mille Milliards de Poèmes de Raymond Queneau.
L’interactivité des Cent Mille Milliards de Poèmes…
Sur l’an 1969, un “fatiguant roman qu’on a, souhaitons-nous, lu sans trop d’omissions“, dixit son « scriptor », G.P (Jojo pour l’intimisation) parait dans l’amas du gros flacon du magasin français. Son bouquin, au “scrivain “, la disparition, il y a un truc qu’il n y a plus, un truc pas tout à fait rond, un G mais dans un profil pas courant, du moins pas un G commun ; “un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal“ dit aussi l’artisan. La lipogrammatisation, pourrait on discourir, concourt à la disparition du disparu, Anton Voyl. Un art pas banal du tout.
G.P (scrivain faisant portion dans l’Ouvroir) magnifia son nom par un roman aussi contraignant.
L’Oulipo salua l’art ici absolu, sans dispositifs abscons ni abstrus dont G.P, l’ahurissant histrion, un « voyant » dirait Rimbaud, a fait l’utilisation.
Georges Perec.
En 1972, les Revenentes de Georges Perec, recréent les gens pressés de ce genre de dépêches.
Des lettres errent se perdent de même des spectres, elles pénètrent les termes et les lexèmes en présence des êtres lettrés décédés.
Bref, Perec présente de belles recettes et révèle ces revenentes.
L’année 1979 est marquée par deux chefs d’œuvres.
Georges Perec publiât la vie mode d’emploi ; “j’imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée […] de telle sorte que, du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s’y déroulent…“. Cette œuvre possède un sous titre : Romans. Le pluriel est important parce que ce livre est en fait une mine de romans, d’histoires. Dans chaque appartements, escaliers, croisement, c’est la vie elle-même qui s’agite, se tord et gesticule. La vie est un roman, plusieurs vies sont des romans. Ce livre développe en effet 107 histoires avec pas moins de 1467 personnages. Le Roman décrit des « processus formels » affirme Perec, d’où le mode d’emploi. La vie mode d’emploi répond à un nombre extraordinaire de contraintes en tout genre (le cahier des charges de l’œuvre est disponible sur le commerce) ; nous en attendions pas moins de ce virtuose oulipien.
L’autre publication qui marque grandement 1979 nous vient d’Italie (ou d’Italo c’est comme on veut). Si par une nuit d’hiver un voyageur est un roman (dire un roman n’est pas très juste) écrit par Italo Calvino. Le lecteur devient le personnage principal de ce livre. Il est lancé dans la lecture d’un roman où, en tant que personnage, il est amené à lire d’autres romans (du moins leur incipit) et a imaginé quelle pourrait bien être leur suite. La simple lecture de la table des matières offre elle-même une histoire. Des contraintes, il en est de grandiose ; le fait de placer le lecteur en tant que personnage entre autres.
Calvino remet en cause toute la conception moderne du roman, parce que le lecteur change comme les mœurs et les temps, le roman réaliste qui commence et se finit ne convient plus à notre époque, nous ne pensons plus que par bribes de temps, « le temps a volé en éclats, c’est un contre sens d’écrire aujourd’hui de long roman » disait Calvino. « Tu vas commencer le nouveau roman d’italo Calvino. Détends-toi. Ecarte de toi toute autre pensée. […]. La porte il vaut mieux la fermée. […].Prends la position la plus confortable […]. Règle la lumière de façon à ne pas te fatiguer la vue ».
Italo Calvino
D’autres entreprises récentes ont marqués la littérature.
« Je pense que je n’ai jamais vu dans le métro quelqu’un en train de lire un de mes livres » dit Hervé Le Tellier dans les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, la Joconde jusqu’à cent du même auteur et très récemment l’Esthétique de l’Oulipo. Foraine et Chamboula de Paul Fournel sont aussi deux récits qui méritent une grande considération. Il en va de même pour les derniers ouvrages de Roubaud.
III
L’OULIPO AVANT L’OULIPO
“En m’esbatant je fais rondeaulx en rithme,
Et en rithmant bien souvent je m’enrime“
Clément Marot
a) Les contraintes du passé.
Dans cette partie nous ne traiterons que de certaines formes ou contraintes qui naquirent jadis entre les mains (ou sous la plume) des plagiaires par anticipation de l’Ouvroir.
La forme qui marqua le plus profondément la poésie occidentale est sans aucun doute le sonnet. Le terme, sonnet, vient de l’italien « sonneto » qui signifie littéralement « petite chanson ». Il est composé de quatorze vers dont la représentation typographique peut variée selon les modes. On établit une distinction entre les sonnets italiens et français pour leur forme fixe. Le sonnet français est un poème comportant quatorze vers, répartis normalement en deux quatrains suivis d’un sizain.
Les deux quatrains présentent le plus souvent, dans la « norme » française, la même disposition des rimes, soit croisées (ABAB), soit embrassées (ABBA) soit plates (AABB). En outre, autrefois (XVIe au XIXe), une alternance de rimes masculines et féminines devait être respectée. Le sizain doit respecter à son tour certaines normes sur la succession de ses rimes : CCDEDE.
Le sonnet français fut très utilisé par les poètes de la Pléiade puis délaissé, il fut remit au gout du jour au XIXème siècle par Gautier, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud.
L’OULIPO a exploité de nombreuses possibilités, dont les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau et la composition de sonnets en prose par Jacques Roubaud, mais aussi le « sonnet irrationnel », baptisé ainsi car il fait fusionner le nombre de vers du sonnet (14) et le nombre irrationnel le plus célèbre, Pi : ainsi les vers sont-ils répartis selon les cinq premiers chiffres de Pi, en strophes de 3, 1, 4, 1 et enfin 5 vers.
Un sonnet Pétrarquéen, aussi appelé sonnet italien, est un sonnet comprenant un huitain, suivi d’un sizain. Le huitain est composé de deux quatrains suivant la forme ABBA. Le sizain, pour sa part, est composé de deux tercets, suivant la forme CCD EED. Le sonnet italien comporte une Volta, ou charnière qui consiste en un changement majeur du sujet, du point de vue ou d’un autre aspect important du sonnet entre le huitain et le sixain. Le plus souvent, le poète identifie une problématique dans la première moitié du poème, la seconde lui permettant de présenter, grâce à la ‘’Volta’’, une réflexion personnelle à propos du problème susmentionné.
Comment ne pas donné en exemple le très célèbre (et du même coup tarte à la crème de l’Oulipo) Le Dormeur du Val de Rimbaud (qui avec la méthode S+7 de Lescure devient Le dortoir des valenciennes… Voir partie sur la contrainte S+7)
Le sonnet est un exemple de démarche oulipienne du passé. Il exige en effet une forme, une typographie, des rimes spécifiques autrement dit : il fixe des contraintes.
Concernant l’Alexandrin, nous pourrions citer Queneau qui déclare : “On peut considérer, que le jour où les Carolingiens se sont mis à compter sur leurs doigts 6, 8 et 12 pour faire des vers, ils ont accomplis un travail oulipien“. L’Alexandrin est un vers de 12 syllabes, sous sa forme classique, il est composé de deux hémistiches. La sixième syllabe correspond à la césure qui est un lieu de contraintes classique. L’alexandrin classique en deux hémistiches de six syllabes a été décrit par Boileau dans L’Art poétique. Il formule ainsi le principe de la césure :
“Que toujours dans vos vers / le sens, coupant les mots
Suspende l’hémistiche, / en marque le repos. “
Ce vers est né au XIIème siècle avec un cycle de poèmes épique retraçant l’histoire d’Alexandre le Grand.
Avant le XVIe siècle, il est rare en français et le vers par excellence est plutôt le décasyllabe. Il est réellement catapulté par la Pléiade, notamment Jean Antoine de Baïf et Pierre de Ronsard.
Les Romantiques usèrent à souhait de cette forme en le modifiant (en affront au classicisme), Victor Hugo déclare de façon classique : “ Nous faisons basculer la balance hémistiche “. Il dira plus tard à propos de la césure et de l’alexandrin : “ J’ai disloqué / ce grand niais / d’alexandrin“. On note ici le travail à la fois anoulipique et synthoulipique de Victor Hugo (alexandrin ternaire) ; retrouver une forme ancienne et la modifier. Le travail de l’Oulipo n’est pas nouveau.
Toute la Tragédie classique repose aussi sur ce principe, sur cette convention ou contrainte.
L’alexandrin est un exemple de travail oulipien par anticipation puisque cette contrainte métrique fixe un nombre de syllabe et dans certains cas une ou plusieurs césures.
Une autre forme très utilisée dans la Tragédie ou la Poésie est l’acrostiche.
L’acrostiche est un poème dont certains éléments forment un autre message. Le texte peut être lu de haut en bas en ne tenant compte que des lettres initiales, médianes ou finales. Ce message est un mot clé, une devise, une sentence, voire un nom propre qui désigne l’auteur, le destinataire du texte. L’acrostiche se présente le plus souvent sous la forme d’un court poème, mais elle peut être aussi une phrase. L’acrostiche peut être simple, double, syllabique…
Un acrostiche a été découvert dans une pièce de Pierre Corneille : Horace (acte II, scène 3) :
“S’attacher au combat contre un autre soi-même,
Attaquer un parti qui prend pour défenseur
Le frère d’une femme et l’amant d’une sœur,
Et rompant tous ces nœuds, s’armer pour la patrie
Contre un sang qu’on voudrait racheter de sa vie,
Une telle vertu n’appartenait qu’à nous ;
L’éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux.“
Villon donne souvent son nom en signature dans l’envoi des ballades :
“Vivons en paix, exterminons discord ;
Ieunes et vieux, soyons tous d’un accord :
La loi le veut, l’apôtre le ramène
Licitement en l’épître romaine ;
Ordre nous faut, etat ou aucun port.
Notons ces points ; ne laissons le vrai port
Par offenser et prendre autrui demaine“.
Ici, Toujours Villon, signe de son nom et signifie la destinataire :
“Fausse beauté, qui tant me coûte cher,
Rude en effet, hypocrite douceur,
Amour dure plus que fer à mâcher,
Nommer te puis, de ma défaçon seur.
Cherme felon, la mort d’un pauvre cœur,
Orgueil mussé qui gens met au mourir,
Yeux sans pitié, ne veux Droit de Rigueur,
Sans empirer, un pauvre secourir ?
Mieux m’eût valu avoir été sercher
Ailleurs secours : c’eût été mon bonheur ;
Rien ne m’eût su lors de ce fait hacher.
Trotter m’en faut en fuite et déshonneur.
Haro, haro, le grand et le mineur !
Et qu’est ce ci ? Mourrai sans coup férir ?
Ou Pitié peut, selon cette teneur,
Sans empirer, un pauvre secourir ?“
Jean Molinet, célèbre poète et Grand Rhétoriqueur, se sert des notes de la gamme pour son acrostiche :
“ UT queant laxis
Mira gestorum
SOLve polluti
Resonare fibris
Famuli tuorum
Labii reatum
Sancte Ioannes“
Les origines de cette contrainte sont très anciennes, et remontent probablement à probablement l’Egypte antique.
On en trouve des traces dans les Psaumes de David (un verset correspondant à une lettre de l’alphabet hébreu ; cette contrainte agit comme un phénomène mnémotechnique étant donné que les psaumes étaient chantés) et dans les Lamentations de Jérémie.
Agissant comme un stimulant pour l’imagination (but de la contrainte d’après l’Oulipo), l’acrostiche prend place au paradis des travaux anticipés de l’Ouvroir.
Le lipogramme n’est pas une invention de l’Oulipo. Le But de cette contrainte est de se priver d’une lettre. Perec affirme que le plus ancien lipogrammatiste serait Lasos d’Hermione au VIème siècle avant Jésus Christ. Il se priva de la lettre sigma dans deux de ses odes (ce qui est un exploit en grec de même que le e en français).
Un autre lipogramme significatif est de Fulgentius au VIème siècle. Dans de aetatibus, un traité “traitant de diverses choses sans intérêt“, disait Perec, composé de 23 chapitres. Dans le premier l’auteur fait abstraction du A, dans le second du B, etc.…
De la Renaissance à nos jours divers auteurs allemands s’inscriront dans la tradition du non-R.
La troisième tradition est vocalique, elle se prive de voyelle. Le plus grand représentant est bien sur Perec avec sa disparition (lipogramme en E) et ses revenentes (tautogramme en E, c’est-à-dire, lipogramme de A, I, U, O, d’où la faute dans le titre). Pour des exemples, référez vous aux paragraphes traitant des deux œuvres précédemment citées.
A propos des tautogrammes, il en existe un, particulièrement spectaculaire, dans la langue chinoise. Le chinois est une langue dite tonale (qui utilise plusieurs tons), la prononciation d’un mot pourra en faire varié le sens. En fait c’est un tautogramme phonique ; un poème qui se décline sur le seul son shi sur tous les tons de la langue. Paul Fournel dit à propos de se poème : “c’est un sommet inaccessible aux langues non tonales comme la notre“.
C’est l’histoire du poète shi qui alla au marché, tua 10 lions et les mangea. (voir ci-après).
施氏食狮史
石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。
试释是事!
Parlons maintenant du palindrome ; ce n’est pas non plus une tradition oulipienne (si ce n’est par anticipation).
Le palindrome est une contrainte littéraire extrêmement ardue lorsqu’il s’agit de composer un texte d’une certaine longueur. Le sens du texte peut alors paraître ténébreux. Le « Grand Palindrome » de Georges Perec est le plus long palindrome publié en français, avec 5 566 lettres, soit le produit de la multiplication palindromique 11x23x2x11.
Le Grand Palindrome de Perec, Un palindrome de 1247 mots.
“Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né Perec. L’arc lu pèse trop, lis à vice-versa.
[…] Désire ce trépas rêvé : Ci va ! S’il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne perturbe le lucre : Haridelle, ta gabegie ne mord ni la plage ni l’écart“.
Relisez cela dans l’autre sens, vous y trouverez exactement la même chose.
Le record mondial, est détenu par Pitkä palindromi, un palindrome en finnois composé par Teemu Paavolainen en 1992 avec 49 935 caractères !
Cette contrainte fut inventée par Sotades, III siècle, et fut reprise à droite à gauche au fil des siècles.
En voila quelques exemples :
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ
« Lave mes péchés et non mes seuls yeux »
In girum imus nocte et consumimur igni
« Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu »
上海自来水来自海上
« l’eau courante de Shanghai arrive de la mer »
 Les plagiaires par anticipation.
Les plagiaires par anticipation.
Dans l’introduction, nous avons vu qu’une tendance avait vu le jour au départ de l’Ouvroir : L’anoulipisme.
Comme précédemment expliqué, ce courant analytique, s’évertue à rechercher dans le passé, les différents auteurs ayant eu une démarche semblable à celle des Oulipiens. Dans une gentillesse extrême relevée d’un peu de bonté, l’Oulipo se refuse à attaquer en justice tous ces auteurs, coupable de plagiat (Loi nº 94-102 du 5 février 1994), qui dans ce cas éventuel devraient peler des oranges pendant 3 ans et payer une somme de plus de 300 000 euros ! Faisant partie de ces écrivains nous mentionnerons Ronsard, Marot, Sotades, Fulgentius, Shi, Mallarmé, Molinet, Villon, Corneille, Hugo, Pétrarque ainsi que d’autres inconnus du même genre…
Cette partie n’entend pas faire une liste exhaustive de tous les plagiaires par anticipation de l’Oulipo, mais plutôt à montrer l’évolution de cette tendance dans la littérature.
Dans les parties précédentes nous en avons rencontré quelques uns qu’il serait inutile et vain de citer à nouveau ici.
En demandant à Paul Fournel quels furent les plus grands plagiaires par anticipation de l’Oulipo, il répond sans hésiter, les Grands Rhétoriqueurs, les poètes du XVI et XVII éme siècle. En effet, ces poètes développèrent un goût pour l’écriture formelle qui annonçait le classicisme. En témoigne ce poème de Marot plein de jeux de mots, d’humour mais en même temps porteur d’un grand message adressé au Roi :
En m’esbatant je faiz Rondeaux en rime,
Et en rimant bien souvent je m’enrime ;
Brief, c’est pitié d’entre nous Rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rime ailleurs,
Et quand mous plaist, mieulx que moy rimassez,
Des biens avez et de la rime assez.
Mais moy, à tout ma rime & ma rimaille,
Je ne soustiens (dont je suis marry) maille.
Or, ce me dist (ung jour) quelque Rimart :
Viença, Marot, trouves tu en rime art
Qui serve aux gens, toy qui as rimassé ?
Ouy vrayement (respondz je) Henri Macé.
Car voys tu bien, la personne rimante,
Qui au Jardin de son sens la rime ente,
Si elle n’a des biens en rimoyant,
Elle prendra plaisir en rime oyant ;
Et m’est advis que, si je ne rimoys,
Mon pauvre corps ne serait nourry moys,
Ne demy jour. Car la moindre rimette,
C’est le plaisir où fault que mon rys mette.
Si vous supply qu’à ce jeune Rimeur
Faciez avoir ung jour par sa rime heur,
Affin qu’on die, en prose ou en rimant :
Ce Rimailleur, qui s’alloit enrimant,
Tant rimasse, lima et rimonna,
Qu’il a congneu quel bien par rime on a.
Outre l’utilisation du vers et de la rime, qui est déjà en soit une contraintes, Marot nourri son épître au Roi d’un double sens. Ce poète fait partie des précurseurs d’une série de plagiaire par anticipation légendaire.
Les jeux de langues de la Pléiade préfiguraient ceux de l’Oulipo par lesquels on peut explorer le langage et ses abîmes les plus profonds. On compte parmi les plagiaires par anticipation des poètes alexandrins, des grands rhétoriqueurs, la Pléiade, certains poètes baroques allemands, des formalistes russes, des écrivains comme Raymond Roussel et Robert Desnos (avec ses jeux sur les sons) et la comedia dell’arte. Reprenons la démarche de ces poètes (ceux du XVI et XVII siècle). Ils vinrent s’assôirent sur les mots lorsque le français n’était encore qu’une langue naissante et ils nourrissaient le désir de l’enrichir, de la sortir de son trou, ils inventèrent, de fait, des mots ou des formes (autrement appelées contraintes) pour élever cette idiome, pour en faire une utilisation poétique et littéraire. Le groupe de la Pléiade se donne pour mission de définir de nouvelles règles poétiques. Dans ce cadre, du Bellay rédige en 1549 une « Défense et illustration de la langue française ». Il y prône l’usage du français en poésie, contre celui du latin, jusqu’alors quasi-exclusif. Son projet est de rendre la langue française moins « barbare et vulgaire » en l’enrichissant avec ses amis de la Pléiade. Il souhaite également re-populariser les genres poétiques utilisés pendant l’antiquité ainsi que l’élégie, le sonnet, etc.…. Ces occupations permettent d’explorer les potentialités de la langue française à un moment où celle-ci est en train de se stabiliser : ces poèmes ont une fonction d’illustration de la langue et c’est en cela que l’activité de ces poètes augure les recherches et exercices de l’Oulipo sur la potentialité linguistique.
Lorsque, en 1960, Queneau et Le Lionnais fondent l’Oulipo, c’est avec «l’idée d’injecter des notions mathématiques inédites dans la création romanesque ou poétique». En ce sens, la démarche de l’Oulipo s’inscrit, tout en l’infléchissant, dans une filiation quintilienne : on rappellera qu’au livre I de l’Institution oratoire, Quintilien pointe les rapports qui existent entre rhétorique et mathématique, les repérant essentiellement dans le processus démonstratif (l’une des branches de la rhétorique). Quintilien fait donc office de plagiaire par anticipation.
Mallarmé s’illustre comme tel, au même titre que Verlaine, par l’utilisation de la musique dans la poésie.
Peuvent être nommé plagiaire par anticipation tout auteurs ayant créés ou utilisés une forme ou une contrainte. Tous les écrivains cités dans la partie sur les contraintes du passé sont des plagiaires par anticipation.
IV
LA LITTERATURE POTENTIELLE
« Prenez un mot, prenez en deux, faites cuire comme des œufs, prenez un petit bout de sens puis un grand morceau d’innocence, faites chauffer à petit feu au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez vous donc en venir ? A écrire vraiment ? A écrire ? »
Raymond Queneau
a) Echantillons de diverses contraintes (synthoulipisme).
Cette partie ne se veut pas être une liste là encore des différentes contraintes Oulipiennes ; elle tend à en montrer quelque unes et à les expliquer.
La littérature combinatoire est une contrainte faisant appelle aux mathématiques (plus particulièrement à des notions établis par Leibniz mais qui prirent tout leur sens à notre époque avec l’astrophysique et les algorithmes informatique).
Pour en donner définition il faut s’appuyer sur le concept de configuration ; on cherche une configuration chaque fois que l’on dispose d’un nombre fini d’objets, et que l’on souhaite les disposer de façon à respecter certaines contraintes fixées à l’avance. De même que l’algèbre étudie les opérations, l’analyse étudie les fonctions, la combinatoire étudie, elle, les configurations. Elle veut démontrer l’existence de configurations d’un type voulu, les dénombrer, etc.… (Elle permet de créé un programme informatique pouvant prévoir comment et dans quelle ordre pousseront les feuille d’un arbre qui n’est encore qu’une graine)
Cette étude a dégagée un grand nombre de concepts mathématiques (autrement appelés dans l’Oulipo : manipulation péri mathématique) aisément extrapolable dans le domaine du langage. L’Oulipo s’immisce dans cette catégorie.
La première œuvre de littérature combinatoire est les cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau. Dans ce recueil l’auteur intègre 10 sonnets de 14 vers, ce qui « combinatoire ment » fait 1014 poèmes différents et qui respectent les règles ou contraintes du sonnet (voir précédemment).
Il existe d’autre forme de littérature combinatoire comme « s+7 » qui consiste à prendre un substantif (s), un verbe (v), etc. et à prendre dans un dictionnaire son correspondant 7 place après la sienne.
Mais sa forme la plus intéressante consiste a transposé des concepts existants dans les divers branches des mathématiques dans le domaine de la littérature.
Par exemple un poème de 10 mots monosyllabiques ; le récitant (en appliquant un concept dit « source ») pourrait inter changeait ces mots et obtenir 3 628 800 poèmes. Avec « n » mots à permuter, le nombre des possibilités serait « factorielle « n » ». (n ! = 1x2x…x n).
En 1965 Saporta publie un roman « factoriel » dont les pages peuvent être lues dans n’importe quel sens.
Une autre forme de poésie combinatoire est celle dites «fibonaccienne» (texte décomposé en n éléments et que l’on récite en utilisant seulement les éléments qui n’était pas juxtaposés dans le texte original) parce qu’avec n éléments, le nombre de poèmes n’est autre que le nombre de fibronacci :
Fn = 1+n ! + (n-1) ! + …
1 ! (n-1) 2 ! (n-3) !
Ce qui fait quelque chose comme cela :
« Feu filant,
Déjà sommeillant,
Bénissez votre
Os
Je prendrai
Une vieille accroupie
Vivez les roses de la vie ! »
Pour des exemples, consulter les cent milles milliards de poèmes. Sinon considérons cela : Le mot « CELLULE ». Le nombre de mots possibles (avec ou sans signification) que l’on peut écrire en permutant ces 7 lettres est :
P7 = 7 !
2 !3 !
= 420 mots possibles
Remarque : En considérant deux groupes de lettres identiques : L (3 fois) et E (2 fois). Voila une utilisation (fort simple et basique) de la combinatoire. Cette branche des mathématiques fait vraisemblablement partie des plus complexe, du moins à un certain niveau. Avec Oulipo il existe 360 combinaisons.
La distributivité, la factorisation, la théorie des ensembles, les algorithmes, la théorie des graphes, sont des pistes de courses potentielles vis-à-vis de cette contrainte pour le moins particulière mais oh combien passionnante.
La méthode S+7 dont Jean Lescure est l’inventeur : il expose la méthode du S+7 lors d’une des premières réunions de l’Oulipo, le 13 février 1961. La méthode S+7 consiste à remplacer chaque substantif (S) d’un texte préexistant par le septième substantif trouvé après lui dans un dictionnaire (S+7) donné.
« L’Étranger » de Baudelaire devient « L’étreinte » :
Qui aimes-tu le mieux, homochromie ennéagonale, dis ? Ta perfection, ton mérinos, ta soif ou ton frétillement ?
Je n’ai ni perfection, ni mérinos, ni soif, ni frétillement.
Tes amidons ?
Vous vous servez là d’un paros dont la sensiblerie m’est restée jusqu’à ce jouteur inconnue.
Ton patron ?
J’ignore sous quel laudanum il est situé.
Le bécard ?
Je l’aimerais volontiers, défaut et immortel.
L’orangeade ?
Je la hais, comme vous haïssez Différenciation.
Eh ! Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étreinte ?
J’aime les nucléarisations… les nucléarisations qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleuses nucléarisations !
Il existe de nombreuses variations de cette contrainte. Raymond Queneau propose des variations sur S+7, en l’étendant à d’autres parties du discours. Ainsi La cimaise et la fraction est-elle le résultat d’un « A (adjectif) +7, Sm (substantif masculin) +7, Sf (substantif féminin) +7, V (verbe) +7 » appliqué à la fable bien connue.
La cimaise ayant chaponné tout l’éternueur
Se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie :
Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou de verrat. […]
La liste de ces variations est encore longue et délicieuse.
Parlons à présent de la littérature définitionnelle. Cette contrainte fut créée en 1966 par Queneau, Bénabou et Perec. Dans un énoncé donné, on remplace chaque vocable signifiant (substantif, adjectif, verbe, adverbe) par une de ses définitions dans un dictionnaire donné ; on réitère l’opération sur le nouvel énoncé obtenu, et ainsi de suite.
Soit un énoncé de départ simple : Le chat a bu le lait
Etape 1 : Le mammifère carnivore digitigrade domestique a avalé un liquide blanc, d’une saveur douce fournie par les femelles des mammifères
Etape 2 : Celui qui a des mamelles, mange de la viande, marche sur l’extrémité de ses doigts et concerne la maison a fait descendre dans le gosier par l’estomac un état de la matière sans forme propre, de la couleur du lait, d’une impression agréable sur l’organe du goût et procuré par les animaux du sexe féminin qui ont des mamelles.
La encore une extension existe : la LSD ou littérature semi définitionnelle.
La littérature en arbre nous renvoie à la théorie des graphes dont l’histoire des 3 alertes petits pois est un exemple. Elle peut être utilisé pour du théâtre, un poème, des nouvelles. Le récit, les rencontres, les images ou autre se feront selon un graphe donné. En exemple, nous vous invitons à considérer Chamboula de Paul Fournel. Sinon voila l’exemple d’un arbre.
Une autre contrainte qui fit époque dans l’enchaînement des longs siècles oulipiens fut la morale élémentaire de Raymond Queneau. Il la définit ainsi : “ D’abord, trois fois trois plus un groupes substantif plus adjectif (ou participe) avec quelques répétitions, rimes, allitérations, échos ad libitum ; puis une sorte d’interludes de sept vers de une à cinq syllabes ; enfin une conclusion de trois plus un groupe substantif plus adjectif reprenant plus ou moins quelques-uns des vingt-quatre mots utilisés dans la première partie. ”
Voir ci-après, morale élémentaire de Queneau.
Voila un autre exemple que nous donnerons de cette forme pour le moins déroutante, proche du haïku japonais mais ô combien délicieuse.
L’alphabet du prisonnier est une contrainte ayant pour but de se priver des lettres à jambages ; c’est donc un lipogramme en b, d, f, g, h, i, j, k, l, p, q, t, y. Le nom de cette contrainte vient de l’image d’un prisonnier ne disposant que de très peut de place pour écrire et qui essaye donc de l’économiser. Nous en donnerons un modeste exemple.
Un cœur écumé envie vos amours, car une scène inavouée crève mon âme à ses rêves marins comme une mer sous un navire emmené sur son sein. Ainsi moussées océanes, aimez ! Aimez ! Comme mon cœur vénère une immense rose amoureuse et rêvassée ; si une vie ne vous va, six m’irons assez.
Il existe des variantes de cette forme, à savoir son inverse : la contrainte du prisonnier libéré, où l’on ne doit utiliser que les voyelles et les lettres à jambage.
Un beau présent est une contrainte inventée par Georges Perec, qui consiste en l’unique utilisation des lettres du nom de la personne à qui s’adresse le poème. Hervé Le Tellier déclare au sujet de cette contrainte : “le « beau présent », par exemple, où l’on s’impose de n’utiliser que les lettres présentes dans des noms et prénoms, suscite des alliances qu’aucune muse n’aurait pu souffler “.
V
LE SENS DE LA DEMARCHE OULIPIENNE
« Au fond, je me donne des règles pour être totalement libre ».
Georges Perec
a) L’Oulipo et l’Esthétique.
Dans son essai sur l’Esthétique de l’Oulipo, Le Tellier déclare : « Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Nous avons vu dans l’introduction qu’en effet le groupe le prétend pas s’unir autour d’une quelconque notion d’esthétique, ce qui de fait ferait de lui un mouvement littéraire.
Ouvrir de manière si emportée un discours sur un sujet aussi fin et délicat que l’esthétique… N’est ce pas la une chose bien curieuse ? Et puis, de la littérature… sans esthétique ?
Pour répondre à de telle questions et comprendre dés lors le sens de la démarche oulipienne, il convient de s’arrêter un instant sur le concept de l’Esthétique.
Dans le langage courant il définit ce qui est beau, agréable aux sens. Ce concept est en fait récent puisqu’il est né au XVIII siècle sous la plume de Baumgarten en tant que néologisme et en tant que nouvelle branche d’étude de la Philosophie. Il procède du grec αισθητική (aisthetike) « sensation, perception », de αίσθησιν (aisthesin) « sens ». Dans son ouvrage Méditations philosophiques (1735), Baumgarten explique son néologisme d’esthétique comme « la science du mode de connaissance et d’exposition sensible », puis dans Æsthetica (1750) : « L’esthétique est la science de la connaissance sensible ». Au XIX siècle ce mot est adopté par la langue française, jadis, on parlait plutôt de « théorie de l’art » ou de « critique d’art ». Dans sa définition la plus évasée, l’esthétique reste une science qui a pour sujet d’étude l’essence et les perceptions du beau, les jugements et émotions qui découlent de ces impressions ainsi que l’art sous tout ces formes et aspects.
L’esthétique peut être prise comme une science normative du beau, au même titre que la morale est celle du bien et la logique celle du vrai. Au-delà de la simple science, elle fut prise comme une métaphysique du beau (entre autre par Platon avec sa théorie des idées) dans le sens où elle se concentrer sur l’inintelligible dans la matière, le reflet de l’idée, de la volonté ou de l’être selon d’autre philosophe (Hegel par exemple).
Ce tableau de Hans Makart illustre des conceptions d’ordre esthétique (le beau chez la femme) mais il émet aussi l’idée que la perception du beau s’effectue par les cinq sens. La littérature est donc ici très à propos.
Les théories esthétiques littéraires sont surtout chevillées par Aristote dans sa Poétique (ces principes seront repris par Boileau pour l’esthétique classique). Il y défend entre autre l’utilisation des figures de style pour le plaisir du récepteur.
Mais nous ne souhaitons pas faire un historique de la pensée sur le concept de beau, laissons cela à des encyclopédies ; Pourquoi ? Parce que nous en avons vu suffisamment pour comprendre ce que Hervé Le Tellier déclare ! L’esthétique est une théorie normative, normale, qui fixe donc des normes. Or L’Oulipo n’obéit pas à de telles considérations ; l’unité, l’existence même du groupe ne repose pas sur des conceptions communes esthétiques. Le classicisme se tenait droit face à des normes esthétiques définit entre autre par Boileau. Le Romantisme unissait les encres autour de la nature, l’amour, la mort et le goût pour les époques mortes. Le symbolisme fixé la barre autour de l’utilisation d’un langage mystique, symbolique, transcendant l’existence par l’utilisation de correspondances. Le surréalisme flottait accroché aux amarres du rêve et de l’inconscient. Que de belles choses, n’est ce pas ? L’Ouvroir de Littérature Potentielle n’a pas cela ; la contrainte et le refus d’une pseudo inspiration voila les mots d’ordres de l’Oulipo. Paul Fournel dit que l’Oulipo ne prétend en rien obéir « à une esthétique orthodoxe », il serait sinon un mouvement littéraire comme expliquer dans l’introduction de ce travail. Le fait de ne pas se soumettre à une telle orthodoxie ne signifie pas que l’Oulipo n’est pas producteur d’une certaine esthétique ; en effet où serait alors la littérature ? Chaque auteur oulipien possède un but esthétique en écrivant, il n’est en rien fixé dans un manifeste (même si il en existe un, il ne parle pas de cet aspect qui est alors laissé à l’appréciation de chaque oulipiens). Prenons je me souviens de Perec, les amnésiques n’ont rien vécus d’inoubliable de Le Tellier, Foraine de Paul Fournel, les romans de Queneau ainsi que ses morales élémentaires… Que de littérature respirant le beau, l’esthétique, une originalité propre a chaque auteur, des conceptions différentes du monde, de la vie, du quotidien et des autres broutilles qui nous entourent ! Tout comme Van Gogh, les membres de l’Oulipo ne peuvent être classés selon des considérations esthétiques ; ils sont oulipiens, littérateur à contraintes (rats dans un labyrinthe), ils ne font pas partie d’un courant, si se n’est celui qui est propre à chacun d’en
BUCHOU Simon
L’OuLiPo :
Histoire d’une Contrainte
Nous souhaitons adresser nos remerciements
les plus sincères :
A Paul Fournel, président de l’Oulipo,
pour avoir accepté de répondre très aimablement à quelques questions,
A Patrick Charrière,
pour nous avoir fait connaître
et expérimenter diverses contraintes Oulipiennes,
lors de délicieux ateliers d’écriture,
A Christophe Charneau, étudiant en chinois,
pour nous avoir fait découvrir un poète de l’empire du milieu
plagiaire par anticipation de l’Oulipo,
dont un poème figurera dans ce dossier,
A tous les oulipiens
pour leurs travaux passionnants,
qu’ils soient vivants ou “excusés aux réunions pour cause de décès“,
Ainsi qu’à ceux, malencontreusement oubliés,
qui nous auront apporté ne serait-ce qu’une aide infime.
“Il n'y a pas d'écriture informe.
Chaque texte a une forme.
Le plus souvent, elle est inconsciente :
c'est la forme à la mode, celle que l'on a appris à l'école, celle qui plaît aux lecteurs, celle qui rapporte de l'argent aux éditeurs.
C'est le roman en ce moment, ça a été la poésie jadis, la tragédie auparavant...
Appliquer la contrainte et réfléchir aux problèmes de forme, c'est prendre conscience de cet état de fait.
C'est aussi le moyen de ruser avec les forces inconscientes individuelles et les formes collectives consensuelles.
C'est le chemin vers une nouvelle façon d'écrire et donc de lire. “
Paul Fournel
[color="#FF0000"]L’OuLiPo :
Histoire d’une contrainte.[/color]
Histoire d’une contrainte.[/color]
Tables des Matières
I INTRODUCTION. P.6
a) Qu’est ce que l’Oulipo ? P.6
II PETITE HISTOIRE DE L’OULIPO. P.11
a) Création et débuts de l’Oulipo P.11
c) Les œuvres classiques de l’Oulipo P.14
III L’OULIPO AVANT L’OULIPO. P.19
a) Les contraintes du passé P.19
- Le sonnet
- L’alexandrin
- L’acrostiche
- Le lipogramme
- Le palindrome
IV LA LITTERATURE POTTENTIELLE. P.28
a) Echantillons de différentes contraintes (synthoulipisme) P.28
- La Littérature combinatoire
- S+7
- La littérature définitionnelle
- L’arbre à théâtre (littérature arborescente)
- La morale élémentaire
- L’alphabet du prisonnier
- Un beau présent
V LE SENS DE LA DEMARCHE OULIPIENNE. P.35
a) L’Oulipo et l’esthétique P.35
à la contrainte P.38
Appendice P.40
Interview intégrale de Paul Fournel P.40
Bibliographie et sources diverses P.42
I
INTRODUCTION
“Oulipiens : Rats qui ont à construire le labyrinthe
Dont ils se proposent de sortir“
Les Oulipiens
a) Qu’est ce que l’Oulipo ?
“Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est ce que Ou ? Qu’est ce que Li ? Qu’est ce que Po ?
Ou, c’est Ouvroir, un atelier où l’on œuvre. Pour fabriquer quoi ? De la Li.
Li, c’est la littérature, ce qu’on lit et que l’on rature. Quelle sorte de Li ? De la Lipo.
Po signifie potentielle. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la fin des temps, en quantité énormes, infinies, pour toutes fins pratiques. “
L’Ouvroir de Littérature Potentiel est un groupe d’écrivains et de mathématiciens dont la démarche se divise en deux catégories : l’anoulipisme et le synthoulipisme.
L’anoulipisme consiste en l’analyse des œuvres du passé pour y déceler des contraintes (parfois inconscientes) éventuelles. Cette tendance analytique à donc pour but de rechercher les plagiaires par anticipation de l’Oulipo (cf. partie correspondante) comme les Grands Rhétoriqueurs entre autre.
Une partie de ce travail sera consacrée aux résultats de cette démarche d’analyse.
Le synthoulipisme constitue le but premier de l’Oulipo à savoir l’invention de contraintes pour obtenir des matrices littéraires potentielle. François Le Lionnais, premier président de l’Ouvroir, déclare au sujet de la tendance synthétique : «Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies, inconnues de nos prédécesseurs ». Sans aucuns doutes ce courant synthétique est le plus actif et le plus spectaculaire des deux, on lui doit entre autre la « méthode S+7 » mise au point par Pierre Lescure dés 1961, la littérature combinatoire, qui permit à Raymond Queneau d’écrire Cent Mille Milliards de Poèmes en dix pages, les poèmes booléens (basé sur la théorie mathématique des ensembles) et bien d’autres… Dans une partie de ce mémoire nous nous pencherons sur certaines contraintes issues du synthoulipisme.
Dans le premier manifeste de l’Oulipo, le Président des premiers siècles oulipiens (l’Ouvroir aime a considérer un an d’activité comme un siècle), François Le Lionnais, déclare : “En résumé l’anoulipisme est voué à la découverte, le synthoulipisme à l’invention. De l’un à l’autre existent mains subtils passages“.
L’utilisation de contraintes dans l’écriture n’est pas nouvelle (c’est la raison d’être de l’anoulipisme). En effet, prenons comme exemple la Tragédie classique qui répond à des contraintes de formes et de contenu (règle des trois unités), la poésie avec tout son attirail de forme fixe, de rimes, etc.… Bien sur la contrainte absolue reste la langue elle-même avec le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison.
A la question « comment voyez-vous la contrainte dans l’écriture ? », Paul Fournel, président de l’Ouvroir, nous a répondu l’épigraphe donné pour ce devoir, que nous citerons à nouveaux ici : “Il n’y a pas d’écriture informe. Chaque texte a une forme. Le plus souvent, elle est inconsciente : c’est la forme à la mode, celle que l’on a appris à l’école, celle qui plait aux lecteurs, celle qui rapporte de l’argent aux éditeurs […] “.
Dés lors, la question que pose l’Oulipo est “doit-on s’en tenir aux recettes connues et refuser obstinément d’imaginer de nouvelles formules ?“.
Certaines personnes, qui pratiquent le contentement avec ferveur répondent que oui ; Le Lionnais les appelaient : “les partisans de l’immobilisme“… Les oulipiens quant à eux pensent évidement que non, de même que les Grands Rhétoriqueurs à leur époque, à propos desquelles Paul Fournel dit ceci : “les poètes du XVIe sont joueurs, graves et parfaits. Ce sont des inventeurs“. Est-il nécessaire de rappeler l’importance de ces poètes sur la langue française, tout juste naissante dans sa forme moderne ? Qui oserait remettre en cause l’aspect littéraire de ces versificateurs ?
Un raisonnement analogue est à fournir vis-à-vis des Oulipiens. Ce sont aussi des joueurs, graves et parfaits, des inventeurs, des alchimistes du langage et des magiciens de la littérature.
“1. Ce n’est pas un mouvement littéraire.
2. Ce n’est pas un séminaire scientifique.
3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire“.
“1. Ce n’est pas un mouvement littéraire “. Ces paroles furent prononcées lors d’une conférence à l’institut Henri Poincaré par un porte-parole de l’Ouvroir. Il est important d’épurer ce point parce que nombreux sont les articles (encyclopédiques ou journalistiques) ou les personnes (professorat ou autre) qui n’hésitent pas à qualifier l’Oulipo de mouvement littéraire.
Qu’est ce qu’un mouvement littéraire ? C’est une question qui est nécessaire pour expliquer pourquoi l’Oulipo ne se revendique pas comme tel.
Un mouvement littéraire répond à des exigences esthétiques, culturelles, historiques et parfois philosophiques.
Prenons le cas du Romantisme. Ce mouvement était opposé à une esthétique classique, il refusait les thèses rationalistes des lumières. Il privilégiait l’expression personnelle en reculant devant les règles formelles et les conventions. Le Romantisme est indissociable des transformations contemporaines qui eurent lieu : transformations sociales et économiques (industrialisation), transformations politiques (Révolution Française et éveils nationaux). Il fut marqué par les thèses de Rousseau, de Lessing et Herder, du système de Fichte et de Schelling.
L’Oulipo n’est en rien assimilable à un courant ou mouvement littéraire comme le Romantisme ou le Surréalisme. Il ne prétend pas défendre une “esthétique orthodoxe“ disait Paul Fournel, il n’en revendique aucune (esthétique), cela ne veut pas dire qu’il n’en produise pas (nous verrons cela dans la dernière partie). Il n’est pas né suite à quelques bouleversements historiques, économiques, sociaux ou autres en tant que réaction.
L’Oulipo n’est tout bonnement qu’un groupe (cette idée n’est en rien réductrice) se livrant à diverses activités ou expérience (c’est aussi un explorateur du langage, cf. dernière partie) littéraire, ce ayant déjà était expliqué il serait vain de revenir là-dessus. Parler de secte serait mal à propos, étant donné la signification littérale du mot secte, en grec « haeresias » ou hérésie (hérésie à quoi ?) ; mais l’idée est là, “ Ce n’est pas un mouvement littéraire“.
“2. Ce n’est pas un séminaire scientifique“. L’idée peut paraître extravagante ou apprêtée. Mais considérant la prédilection de l’Oulipo pour les mathématiques cela peut être en effet troublant.
Pour comprendre cela il faut simplement appréhender quelle est la place des mathématiques dans l’Ouvroir ; des noms comme François le Lionnais (auteur d’une encyclopédie sur les mathématiques) et Claude Berge (sorcier de la théorie des graphes) font honneur à cette discipline au sein de l’Oulipo.
Une partie traitera plus particulièrement du sujet, mais disons simplement que les oulipiens ont transformés ou utilisés des concepts mathématiques pour les transcrire ou représentés en produit littéraire. Cette science est donc présente dans les activités de ce groupe pour en servir l’aspect littéraire. De là naquirent les contraintes de littérature combinatoire, de poème booléens, de sonnets irrationnels et de bien d’autre. Cet aspect de la synthèse oulipienne est nommé synthoulipisme périmathématique. Comme l’acronyme OU_LI_PO l’indique ce groupe est avant tout esclave de la littérature donc : “ Ce n’est pas un séminaire scientifique “.
“3. Ce n’est pas de la littérature aléatoire“. On pourrait, en toute ignorance, dire que la productivité oulipienne se résume au hasard dû à l’utilisation de la contrainte.
Opposons à cela une phrase de Raymond Queneau : “il n’y a de littérature que volontaire“. Contrairement aux surréalistes, les oulipiens n’exploitent pas cet aspect du hasard, comme par exemple la pratique du cadavre exquis.
Mais la littérature aléatoire est aussi une œuvre laissant une grande place au choix du lecteur et c’est plus à ce titre que l’on pourrait penser cela de l’Oulipo.
Prenons donc un exemple, à savoir, l’histoire des trois alertes petits pois : un conte à votre façon de Queneau (voir ci-après le graphe et le conte). Le principe est simple : un carré divisé en vingt et une cases, dans chaque cases le fragment d’une histoire, à la fin de ce fragment le lecteur est invité à choisir comment se poursuivra l’histoire en choisissant un renvoi vers une autre case déterminé par l’auteur ainsi de suite jusqu’à la fin de l’histoire.
Cette œuvre est elle aléatoire parce qu’elle laisse un choix relatif au lecteur ? Le lecteur n’a véritablement aucun choix ; c’est en réalité le graphe (cette notion sera abordée plus en détails dans les sous parties « littérature combinatoire » et « littérature arborescente ») qui décide pour lui, le graphe étant façonné par l’auteur. Chaque choix que le lecteur pourrait faire est déjà potentiellement fait par un schéma mathématique. Il en va de même pour les cent mille milliard de poèmes et autre œuvres prétendument aléatoires. “ Ce n’est pas de la littérature aléatoire“.
1. Désirez-vous connaître l’histoire des trois alertes petits pois ?
a. si oui, passez à 4
b. si non, passez à 2
2. Préférez-vous celle des trois minces grands échalas ?
a. si oui, passez à 16
b. si non, passez à 3
3. Préférez-vous celle des trois moyens médiocres arbustes ?
a. si oui, passez à 17
b. si non, passez à 21
4. Il y avait une fois trois petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur cosse.
Leur visage bien rond respirait par les trous de leurs narines et l’on entendait leur ronflement
doux et harmonieux.
a. si vous préférez une autre description, passez à 9
b. si celle-ci vous convient, passez à 5
5. Ils ne rêvaient pas. Ces petits êtres en effet ne rêvent jamais.
a. si vous préférez qu’ils rêvent, passez à 6
b. sinon, passez à 7
6. Ils rêvaient. Ces petits êtres en effet rêvent toujours et leurs nuits sécrètent des songes
charmants.
a. si vous désirez connaître ces songes passez à 11
b. si vous n’y tenez pas, vous passez à 7
7. Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes chaussettes et ils portaient au lit des gants
de velours noir.
a. si vous préférez des gants d’une autre couleur passez à 8
b. si cette couleur vous convient, passez à 10.
8. Ils portaient au lit des gants de velours bleu.
a. si vous préférez des gants d’une autre couleur, passez à 7
b. si cette couleur vous convient, passez à 10
9. Il y avait une fois trois petits pois qui roulaient leur bosse sur les grands chemins. Le soir
venu, fatigués et las, ils s’endormirent très rapidement.
a. si vous désirez connaître la suite, passez à 5
b. si non, passez à 21
10. Tous les trois faisaient le même rêve, ils s’aimaient en effet tendrement et, en bons fiers
trumeaux, songeaient toujours semblablement.
a. si vous désirez connaître leur rêve, passez à 11
b. si non, passez à 12
11. Ils rêvaient qu’ils allaient chercher leur soupe à la cantine populaire et qu’en ouvrant leur
gamelle ils découvraient que c’était de la soupe d’ers. D’horreur, ils se réveillaient.
a. si vous voulez savoir pourquoi ils s’éveillent d’horreur, consultez le Larousse au mot
«ers» et n’en parlons plus
b. si vous jugez inutile d’approfondir la question, passez à 12
12. Opopoï ! S’écrient-ils en ouvrant les yeux. Opopoï ! Quel songe avons-nous enfanté là !
Mauvais présage, dit le premier. Oui-da, dit le second, c’est bien vrai, me voilà triste. Ne
vous troublez pas ainsi, dit le troisième qui était le plus futé, il ne s’agit pas de s’émouvoir,
mais de comprendre, bref je m’en vais vous analyser ça.
a. si vous désirez connaître tout de suite l’interprétation de ce songe, passez à 15
b. si vous souhaitez au contraire connaître les réactions des deux autres, passez à 13
13. Tu nous la bailles belle, dit le premier. Depuis quand sais-tu analyser les songes ? Oui,
depuis quand sais-tu analyser les songes ? Oui, depuis quand ? Ajouta le second.
a. si vous désirez aussi savoir depuis quand, passez à 14
b. si non, passez à 14 tout de même, car vous ne le saurez pas plus
14. Depuis quand ? S’écria le troisième. Est-ce que je sais moi ! Le fait est que je pratique la
chose. Vous allez voir !
a. si vous voulez vous aussi voir, passez à 15
b. si non, passez également à 15, car vous ne verrez rien.
15. Eh bien ! Voyons, dirent ses frères. Votre ironie ne me plaît pas, répliqua l’autre, et vous ne
saurez rien. D’ailleurs, au cours de cette conversation d’un ton assez vif, votre sentiment
d’horreur ne s’est-il pas estompé ? Effacé même ? Alors quoi bon remuer le bourbier de votre
inconscient de papilionacées ? Allons plutôt nous laver à la fontaine et saluer ce gai matin
dans l’hygiène et la sainte euphorie ! Aussitôt dit, aussitôt fait : les voilà qui se glissent hors
de leur cosse, se laissent doucement rouler sur le sol et puis au petit trot gagnent
joyeusement le théâtre de leurs ablutions.
a. si vous désirez savoir ce qui se passe sur le théâtre de leurs ablutions, passez à 16
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
16. Trois grands échalas les regardaient faire.
a. si les trois échalas vous déplaisent, passez à 21
b. s’ils vous conviennent, passez à 18
17. Trois moyens médiocres arbustes les regardaient faire.
a. si les trois moyens médiocres arbustes vous déplaisent, passez à 21
b. s’ils vous conviennent, passez à 18
18. Se voyant ainsi zyeutés, les trois alertes petits pois qui étaient fort pudiques s’ensauvèrent.
a. si vous désirez savoir ce qu’ils firent ensuite, passez à 19
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
19. Ils coururent bien fort pour regagner leur cosse et, refermant celle-ci derrière eux, s’y
endormirent de nouveau.
a. si vous désirez connaître la suite, passez à 20
b. si vous ne le désirez pas, vous passez à 21
20. Il n’y a pas de suite le conte est terminé.
21. Dans ce cas, le conte est également terminé.
II
PETITE HISTOIRE DE L’OULIPO
“Jean Queval intervint pour demander
Si l’on est pour les fous littéraires.
A cette question délicate, F. Le Lionnais répondit fort subtilement :
-Nous ne sommes pas contre mais la vocation littéraire
nous intéresse avant tout“.
Compte rendu de la réunion du 13 février 1961
a) Création de l’Oulipo.
“Quand j’ai rencontré Le Lionnais, qui est un ami, il m’a proposé de faire une sorte de groupe de recherche de littérature expérimentale“ déclara Raymond Queneau. C’est donc cet écrivain et ce mathématicien qui fondèrent l’Oulipo en 1960. Enfin… ils fondèrent le SLE, Séminaire de Littérature Expérimentale. C’est en fait un mois plus tard qu’il prit le nom d’Oulipo ou plutôt d’Olipo. L’Oulipo comme nous l’entendons, naquis ou fit acte de son nom actuel grâce au secrétaire général particulier du Vice-Curateur Baron du Collège de Pataphysique qui suggéra d’ajouter le « u » d’ouvroir pour l’équilibre de l’acronyme. Le Lionnais fut le premier président de l’Ouvroir.
Les oulipiens accordèrent leurs soins à la HLE ou Histoire de Littératures Expérimentales qui aujourd’hui porte le nom d’anoulipisme : la recherche des plagiaires par anticipation de l’Oulipo. Mais comme le montre l’épigraphe de cette partie le montre : “ la vocation littéraire nous intéresse avant tout“, la recherche et l’exploration du langage demeuraient le but premier. L’Oulipo commença à rechercher la potentialité dans la littérature qui était et est à faire.
Même mort on reste oulipien. De ce fait l’Oulipo compte un certain nombre « d’esclaves » parfois excusés aux réunions pour cause de décès, d’après l’expression oulipienne, qui sont :
Noël Arnaud, Valérie Beaudouin, Marcel Bénabou, Jacques Bens, Claude Berge, André Blavier, Paul Braffort, Italo Calvino, François Caradec, Bernard Cerquiglini, Ross Chambers, Stanley Chapman, Marcel Duchamp, Jacques Duchateau, Luc Étienne, Frédéric Forte, Paul Fournel, Anne F. Garréta, Michelle Grangaud, Jacques Jouet, Latis, François Le Lionnais, Hervé Le Tellier, Jean Lescure, Harry Mathews, Michèle Métail, Ian Monk, Oskar Pastior, Georges Perec, Raymond Queneau, Jean Queval, Pierre Rosenstiehl, Jacques Roubaud, Olivier Salon, Albert-Marie Schmidt.
Le second président fut Noël Arnaud et aujourd’hui c’est donc Paul Fournel qui en assume la tâche.
En lui demandant en quoi consistait son rôle de Président, Paul Fournel a répondu par courrier électronique : « Mon travail de Président consiste à me comporter comme les autres membres !
En plus, et en complicité avec notre Secrétaire Provisoirement Définitif, Marcel Bénabou, et la trésorière, je m’occupe de la partie administrative de la vie du groupe : signature des contrats avec les éditeurs, avec les programmateurs, papiers administratifs divers. C’est également au Président que revient la charge de rédiger les préfaces aux volumes collectifs et autres présentations ici ou là. Rien de spectaculaire ».
Paul Fournel, actuel président de l’Ouvroir de Littérature Potentielle.
Paul Fournel s’explique sur la façon dont sont recrutés les membres de l’Ouvroir et sur son enrôlement par Raymond Queneau : «Nous recrutons par cooptation. Nous repérons des jeunes écrivains ou mathématiciens qui nous intéressent. Nous les lisons, nous les invitons à déjeuner et ensuite nous les adoptons – s’ils sont d’accord bien sûr et si nous sommes unanimes. J’ai été recruté comme esclave à l’Oulipo en 1971 par Raymond Queneau sur qui j’avais écrit mon mémoire de Maîtrise et à qui j’avais donné mon premier manuscrit de fiction. Je suis allé rendre hommage au Président Le Lionnais qui était mon voisin et je me suis mis au travail. A quelque temps de là je suis devenu Secrétaire Provisoirement Définitif puis plus tard Président ».
Précisons qu’il ne faut jamais demander à faire partie de l’Oulipo sauf si vous ne voulez pas en faire partie.
Une fois par mois, dans un théâtre à Paris, sont organisés les jeudis de l’Oulipo. C’est un moment de lectures publiques la plus part du temps inédites.
De même, une réunion est organisée tous les mois, où les oulipiens se retrouvent pour dîner ou déjeuner, une partie de la réunion porte sur la création, un oulipien au moins apporte un travail portant soit sur une nouvelle contrainte soit sur une déjà existante.
Parfois, ces créations sont publiées dans « la bibliothèque oulipienne », un opuscule tiré à cent cinquante exemplaires qui échappent aux règles du commerce du livre.
Paul Fournel expose à propos de ces réunions : “ Les réunions sont mensuelles depuis l’origine. Elles sont réservées aux membres et aux éventuels invités d’honneur. En général nous sommes entre 8 et 12. L’ordre du jour comporte la rubrique création qui doit être emplie“.
L’Oulipo fait partie d’une série d’OuXpo.
Il existe en effet une longue liste d’Ouvroirs qui exploitent le concept de potentialité dans leur domaine respectifs. L’Oupeinpo se charge de la peinture, L’Oulipopo est l’Ouvroir de Littérature Policière potentielle, l’Oubapo œuvre dans la bande dessinée, l’Oumupo potentialise la musique, l’Ou’inpo travail dans l’informatique.
Il en existe pour le cinéma, l’histoire, la cuisine, l’architecture, la géographie et bien d’autres disciplines.
c) Les œuvres classiques de l’Oulipo.
Raymond Queneau
Commençons par le commencement. La première œuvre “marquante“ ou devenue classique de l’Oulipo est bien évidement les Cent Mille Milliards de Poèmes de Raymond Queneau, publiée en 1961. C’est là un livre qui exploite la conception de Littérature Potentielle de façon absolue. Dix sonnets (donc de quatorze vers) sont donnés, sur dix pages, chaque vers est inscrit sur une languette qui étant soulevée, laisse apparaître le vers du sonnet suivant, ce sur chaque vers et sur chaque page. Nous avons donc potentiellement 1014 (100 000 000 000 000) poèmes, soit cent mille milliards (10 étant le nombre de sonnet et l’exposant 14 le nombre de vers de chaque sonnets), voir les images ci-après.
Cette forme de poésie est dites exponentielle parce que cette méthode s’obtient avec soit n un nombre de vers (14 pour le sonnet) obéissant à la fonction exponentielle 10n , mais ce n’est qu’un détail lexicographique mathématique. Pour souligner la valeur hautement potentielle de son recueil de poème, Queneau déclare : “En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 seconde pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d’un million de siècle de lecture, et en lisant toute la journée 365 jours par an, pour 190 258 751 années plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autre détails“.
Ce livre est aussi l’acte de naissance de la littérature combinatoire.
Plan des Cents Mille Milliards de Poèmes de Raymond Queneau.
L’interactivité des Cent Mille Milliards de Poèmes…
Sur l’an 1969, un “fatiguant roman qu’on a, souhaitons-nous, lu sans trop d’omissions“, dixit son « scriptor », G.P (Jojo pour l’intimisation) parait dans l’amas du gros flacon du magasin français. Son bouquin, au “scrivain “, la disparition, il y a un truc qu’il n y a plus, un truc pas tout à fait rond, un G mais dans un profil pas courant, du moins pas un G commun ; “un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal“ dit aussi l’artisan. La lipogrammatisation, pourrait on discourir, concourt à la disparition du disparu, Anton Voyl. Un art pas banal du tout.
G.P (scrivain faisant portion dans l’Ouvroir) magnifia son nom par un roman aussi contraignant.
L’Oulipo salua l’art ici absolu, sans dispositifs abscons ni abstrus dont G.P, l’ahurissant histrion, un « voyant » dirait Rimbaud, a fait l’utilisation.
Georges Perec.
En 1972, les Revenentes de Georges Perec, recréent les gens pressés de ce genre de dépêches.
Des lettres errent se perdent de même des spectres, elles pénètrent les termes et les lexèmes en présence des êtres lettrés décédés.
Bref, Perec présente de belles recettes et révèle ces revenentes.
L’année 1979 est marquée par deux chefs d’œuvres.
Georges Perec publiât la vie mode d’emploi ; “j’imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée […] de telle sorte que, du rez-de-chaussée aux mansardes, toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s’y déroulent…“. Cette œuvre possède un sous titre : Romans. Le pluriel est important parce que ce livre est en fait une mine de romans, d’histoires. Dans chaque appartements, escaliers, croisement, c’est la vie elle-même qui s’agite, se tord et gesticule. La vie est un roman, plusieurs vies sont des romans. Ce livre développe en effet 107 histoires avec pas moins de 1467 personnages. Le Roman décrit des « processus formels » affirme Perec, d’où le mode d’emploi. La vie mode d’emploi répond à un nombre extraordinaire de contraintes en tout genre (le cahier des charges de l’œuvre est disponible sur le commerce) ; nous en attendions pas moins de ce virtuose oulipien.
L’autre publication qui marque grandement 1979 nous vient d’Italie (ou d’Italo c’est comme on veut). Si par une nuit d’hiver un voyageur est un roman (dire un roman n’est pas très juste) écrit par Italo Calvino. Le lecteur devient le personnage principal de ce livre. Il est lancé dans la lecture d’un roman où, en tant que personnage, il est amené à lire d’autres romans (du moins leur incipit) et a imaginé quelle pourrait bien être leur suite. La simple lecture de la table des matières offre elle-même une histoire. Des contraintes, il en est de grandiose ; le fait de placer le lecteur en tant que personnage entre autres.
Calvino remet en cause toute la conception moderne du roman, parce que le lecteur change comme les mœurs et les temps, le roman réaliste qui commence et se finit ne convient plus à notre époque, nous ne pensons plus que par bribes de temps, « le temps a volé en éclats, c’est un contre sens d’écrire aujourd’hui de long roman » disait Calvino. « Tu vas commencer le nouveau roman d’italo Calvino. Détends-toi. Ecarte de toi toute autre pensée. […]. La porte il vaut mieux la fermée. […].Prends la position la plus confortable […]. Règle la lumière de façon à ne pas te fatiguer la vue ».
Italo Calvino
D’autres entreprises récentes ont marqués la littérature.
« Je pense que je n’ai jamais vu dans le métro quelqu’un en train de lire un de mes livres » dit Hervé Le Tellier dans les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, la Joconde jusqu’à cent du même auteur et très récemment l’Esthétique de l’Oulipo. Foraine et Chamboula de Paul Fournel sont aussi deux récits qui méritent une grande considération. Il en va de même pour les derniers ouvrages de Roubaud.
III
L’OULIPO AVANT L’OULIPO
“En m’esbatant je fais rondeaulx en rithme,
Et en rithmant bien souvent je m’enrime“
Clément Marot
a) Les contraintes du passé.
Dans cette partie nous ne traiterons que de certaines formes ou contraintes qui naquirent jadis entre les mains (ou sous la plume) des plagiaires par anticipation de l’Ouvroir.
La forme qui marqua le plus profondément la poésie occidentale est sans aucun doute le sonnet. Le terme, sonnet, vient de l’italien « sonneto » qui signifie littéralement « petite chanson ». Il est composé de quatorze vers dont la représentation typographique peut variée selon les modes. On établit une distinction entre les sonnets italiens et français pour leur forme fixe. Le sonnet français est un poème comportant quatorze vers, répartis normalement en deux quatrains suivis d’un sizain.
Les deux quatrains présentent le plus souvent, dans la « norme » française, la même disposition des rimes, soit croisées (ABAB), soit embrassées (ABBA) soit plates (AABB). En outre, autrefois (XVIe au XIXe), une alternance de rimes masculines et féminines devait être respectée. Le sizain doit respecter à son tour certaines normes sur la succession de ses rimes : CCDEDE.
Le sonnet français fut très utilisé par les poètes de la Pléiade puis délaissé, il fut remit au gout du jour au XIXème siècle par Gautier, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud.
L’OULIPO a exploité de nombreuses possibilités, dont les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau et la composition de sonnets en prose par Jacques Roubaud, mais aussi le « sonnet irrationnel », baptisé ainsi car il fait fusionner le nombre de vers du sonnet (14) et le nombre irrationnel le plus célèbre, Pi : ainsi les vers sont-ils répartis selon les cinq premiers chiffres de Pi, en strophes de 3, 1, 4, 1 et enfin 5 vers.
Un sonnet Pétrarquéen, aussi appelé sonnet italien, est un sonnet comprenant un huitain, suivi d’un sizain. Le huitain est composé de deux quatrains suivant la forme ABBA. Le sizain, pour sa part, est composé de deux tercets, suivant la forme CCD EED. Le sonnet italien comporte une Volta, ou charnière qui consiste en un changement majeur du sujet, du point de vue ou d’un autre aspect important du sonnet entre le huitain et le sixain. Le plus souvent, le poète identifie une problématique dans la première moitié du poème, la seconde lui permettant de présenter, grâce à la ‘’Volta’’, une réflexion personnelle à propos du problème susmentionné.
Comment ne pas donné en exemple le très célèbre (et du même coup tarte à la crème de l’Oulipo) Le Dormeur du Val de Rimbaud (qui avec la méthode S+7 de Lescure devient Le dortoir des valenciennes… Voir partie sur la contrainte S+7)
Le sonnet est un exemple de démarche oulipienne du passé. Il exige en effet une forme, une typographie, des rimes spécifiques autrement dit : il fixe des contraintes.
Concernant l’Alexandrin, nous pourrions citer Queneau qui déclare : “On peut considérer, que le jour où les Carolingiens se sont mis à compter sur leurs doigts 6, 8 et 12 pour faire des vers, ils ont accomplis un travail oulipien“. L’Alexandrin est un vers de 12 syllabes, sous sa forme classique, il est composé de deux hémistiches. La sixième syllabe correspond à la césure qui est un lieu de contraintes classique. L’alexandrin classique en deux hémistiches de six syllabes a été décrit par Boileau dans L’Art poétique. Il formule ainsi le principe de la césure :
“Que toujours dans vos vers / le sens, coupant les mots
Suspende l’hémistiche, / en marque le repos. “
Ce vers est né au XIIème siècle avec un cycle de poèmes épique retraçant l’histoire d’Alexandre le Grand.
Avant le XVIe siècle, il est rare en français et le vers par excellence est plutôt le décasyllabe. Il est réellement catapulté par la Pléiade, notamment Jean Antoine de Baïf et Pierre de Ronsard.
Les Romantiques usèrent à souhait de cette forme en le modifiant (en affront au classicisme), Victor Hugo déclare de façon classique : “ Nous faisons basculer la balance hémistiche “. Il dira plus tard à propos de la césure et de l’alexandrin : “ J’ai disloqué / ce grand niais / d’alexandrin“. On note ici le travail à la fois anoulipique et synthoulipique de Victor Hugo (alexandrin ternaire) ; retrouver une forme ancienne et la modifier. Le travail de l’Oulipo n’est pas nouveau.
Toute la Tragédie classique repose aussi sur ce principe, sur cette convention ou contrainte.
L’alexandrin est un exemple de travail oulipien par anticipation puisque cette contrainte métrique fixe un nombre de syllabe et dans certains cas une ou plusieurs césures.
Une autre forme très utilisée dans la Tragédie ou la Poésie est l’acrostiche.
L’acrostiche est un poème dont certains éléments forment un autre message. Le texte peut être lu de haut en bas en ne tenant compte que des lettres initiales, médianes ou finales. Ce message est un mot clé, une devise, une sentence, voire un nom propre qui désigne l’auteur, le destinataire du texte. L’acrostiche se présente le plus souvent sous la forme d’un court poème, mais elle peut être aussi une phrase. L’acrostiche peut être simple, double, syllabique…
Un acrostiche a été découvert dans une pièce de Pierre Corneille : Horace (acte II, scène 3) :
“S’attacher au combat contre un autre soi-même,
Attaquer un parti qui prend pour défenseur
Le frère d’une femme et l’amant d’une sœur,
Et rompant tous ces nœuds, s’armer pour la patrie
Contre un sang qu’on voudrait racheter de sa vie,
Une telle vertu n’appartenait qu’à nous ;
L’éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux.“
Villon donne souvent son nom en signature dans l’envoi des ballades :
“Vivons en paix, exterminons discord ;
Ieunes et vieux, soyons tous d’un accord :
La loi le veut, l’apôtre le ramène
Licitement en l’épître romaine ;
Ordre nous faut, etat ou aucun port.
Notons ces points ; ne laissons le vrai port
Par offenser et prendre autrui demaine“.
Ici, Toujours Villon, signe de son nom et signifie la destinataire :
“Fausse beauté, qui tant me coûte cher,
Rude en effet, hypocrite douceur,
Amour dure plus que fer à mâcher,
Nommer te puis, de ma défaçon seur.
Cherme felon, la mort d’un pauvre cœur,
Orgueil mussé qui gens met au mourir,
Yeux sans pitié, ne veux Droit de Rigueur,
Sans empirer, un pauvre secourir ?
Mieux m’eût valu avoir été sercher
Ailleurs secours : c’eût été mon bonheur ;
Rien ne m’eût su lors de ce fait hacher.
Trotter m’en faut en fuite et déshonneur.
Haro, haro, le grand et le mineur !
Et qu’est ce ci ? Mourrai sans coup férir ?
Ou Pitié peut, selon cette teneur,
Sans empirer, un pauvre secourir ?“
Jean Molinet, célèbre poète et Grand Rhétoriqueur, se sert des notes de la gamme pour son acrostiche :
“ UT queant laxis
Mira gestorum
SOLve polluti
Resonare fibris
Famuli tuorum
Labii reatum
Sancte Ioannes“
Les origines de cette contrainte sont très anciennes, et remontent probablement à probablement l’Egypte antique.
On en trouve des traces dans les Psaumes de David (un verset correspondant à une lettre de l’alphabet hébreu ; cette contrainte agit comme un phénomène mnémotechnique étant donné que les psaumes étaient chantés) et dans les Lamentations de Jérémie.
Agissant comme un stimulant pour l’imagination (but de la contrainte d’après l’Oulipo), l’acrostiche prend place au paradis des travaux anticipés de l’Ouvroir.
Le lipogramme n’est pas une invention de l’Oulipo. Le But de cette contrainte est de se priver d’une lettre. Perec affirme que le plus ancien lipogrammatiste serait Lasos d’Hermione au VIème siècle avant Jésus Christ. Il se priva de la lettre sigma dans deux de ses odes (ce qui est un exploit en grec de même que le e en français).
Un autre lipogramme significatif est de Fulgentius au VIème siècle. Dans de aetatibus, un traité “traitant de diverses choses sans intérêt“, disait Perec, composé de 23 chapitres. Dans le premier l’auteur fait abstraction du A, dans le second du B, etc.…
De la Renaissance à nos jours divers auteurs allemands s’inscriront dans la tradition du non-R.
La troisième tradition est vocalique, elle se prive de voyelle. Le plus grand représentant est bien sur Perec avec sa disparition (lipogramme en E) et ses revenentes (tautogramme en E, c’est-à-dire, lipogramme de A, I, U, O, d’où la faute dans le titre). Pour des exemples, référez vous aux paragraphes traitant des deux œuvres précédemment citées.
A propos des tautogrammes, il en existe un, particulièrement spectaculaire, dans la langue chinoise. Le chinois est une langue dite tonale (qui utilise plusieurs tons), la prononciation d’un mot pourra en faire varié le sens. En fait c’est un tautogramme phonique ; un poème qui se décline sur le seul son shi sur tous les tons de la langue. Paul Fournel dit à propos de se poème : “c’est un sommet inaccessible aux langues non tonales comme la notre“.
C’est l’histoire du poète shi qui alla au marché, tua 10 lions et les mangea. (voir ci-après).
施氏食狮史
石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。
试释是事!
Version pinyin (pronunciation)
shī shì shí shī shǐ
shí shì shī shì shī shì shì shī shì shí shí shī shī shì shí shí shì shì shì shī shí shí shì shí shī shì shì shì shí shì shī shì shì shì shì shì shì shí shī shì shǐ shì shǐ shì shí shī shì shì shì shí shì shí shī shī shì shí shì shí shì shī shì shǐ shì shì shí shì shí shì shì shì shǐ shì shí shì shí shī shī shí shí shǐ shí shì shí shī shī shí shí shí shī shī shì shì shì shì
shì shì shì shì
shī shì shí shī shǐ
shí shì shī shì shī shì shì shī shì shí shí shī shī shì shí shí shì shì shì shī shí shí shì shí shī shì shì shì shí shì shī shì shì shì shì shì shì shí shī shì shǐ shì shǐ shì shí shī shì shì shì shí shì shí shī shī shì shí shì shí shì shī shì shǐ shì shì shí shì shí shì shì shì shǐ shì shí shì shí shī shī shí shí shǐ shí shì shí shī shī shí shí shí shī shī shì shì shì shì
shì shì shì shì
Parlons maintenant du palindrome ; ce n’est pas non plus une tradition oulipienne (si ce n’est par anticipation).
Le palindrome est une contrainte littéraire extrêmement ardue lorsqu’il s’agit de composer un texte d’une certaine longueur. Le sens du texte peut alors paraître ténébreux. Le « Grand Palindrome » de Georges Perec est le plus long palindrome publié en français, avec 5 566 lettres, soit le produit de la multiplication palindromique 11x23x2x11.
Le Grand Palindrome de Perec, Un palindrome de 1247 mots.
“Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né Perec. L’arc lu pèse trop, lis à vice-versa.
[…] Désire ce trépas rêvé : Ci va ! S’il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne perturbe le lucre : Haridelle, ta gabegie ne mord ni la plage ni l’écart“.
Relisez cela dans l’autre sens, vous y trouverez exactement la même chose.
Le record mondial, est détenu par Pitkä palindromi, un palindrome en finnois composé par Teemu Paavolainen en 1992 avec 49 935 caractères !
Cette contrainte fut inventée par Sotades, III siècle, et fut reprise à droite à gauche au fil des siècles.
En voila quelques exemples :
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ
« Lave mes péchés et non mes seuls yeux »
In girum imus nocte et consumimur igni
« Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu »
上海自来水来自海上
« l’eau courante de Shanghai arrive de la mer »
Dans l’introduction, nous avons vu qu’une tendance avait vu le jour au départ de l’Ouvroir : L’anoulipisme.
Comme précédemment expliqué, ce courant analytique, s’évertue à rechercher dans le passé, les différents auteurs ayant eu une démarche semblable à celle des Oulipiens. Dans une gentillesse extrême relevée d’un peu de bonté, l’Oulipo se refuse à attaquer en justice tous ces auteurs, coupable de plagiat (Loi nº 94-102 du 5 février 1994), qui dans ce cas éventuel devraient peler des oranges pendant 3 ans et payer une somme de plus de 300 000 euros ! Faisant partie de ces écrivains nous mentionnerons Ronsard, Marot, Sotades, Fulgentius, Shi, Mallarmé, Molinet, Villon, Corneille, Hugo, Pétrarque ainsi que d’autres inconnus du même genre…
Cette partie n’entend pas faire une liste exhaustive de tous les plagiaires par anticipation de l’Oulipo, mais plutôt à montrer l’évolution de cette tendance dans la littérature.
Dans les parties précédentes nous en avons rencontré quelques uns qu’il serait inutile et vain de citer à nouveau ici.
En demandant à Paul Fournel quels furent les plus grands plagiaires par anticipation de l’Oulipo, il répond sans hésiter, les Grands Rhétoriqueurs, les poètes du XVI et XVII éme siècle. En effet, ces poètes développèrent un goût pour l’écriture formelle qui annonçait le classicisme. En témoigne ce poème de Marot plein de jeux de mots, d’humour mais en même temps porteur d’un grand message adressé au Roi :
En m’esbatant je faiz Rondeaux en rime,
Et en rimant bien souvent je m’enrime ;
Brief, c’est pitié d’entre nous Rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rime ailleurs,
Et quand mous plaist, mieulx que moy rimassez,
Des biens avez et de la rime assez.
Mais moy, à tout ma rime & ma rimaille,
Je ne soustiens (dont je suis marry) maille.
Or, ce me dist (ung jour) quelque Rimart :
Viença, Marot, trouves tu en rime art
Qui serve aux gens, toy qui as rimassé ?
Ouy vrayement (respondz je) Henri Macé.
Car voys tu bien, la personne rimante,
Qui au Jardin de son sens la rime ente,
Si elle n’a des biens en rimoyant,
Elle prendra plaisir en rime oyant ;
Et m’est advis que, si je ne rimoys,
Mon pauvre corps ne serait nourry moys,
Ne demy jour. Car la moindre rimette,
C’est le plaisir où fault que mon rys mette.
Si vous supply qu’à ce jeune Rimeur
Faciez avoir ung jour par sa rime heur,
Affin qu’on die, en prose ou en rimant :
Ce Rimailleur, qui s’alloit enrimant,
Tant rimasse, lima et rimonna,
Qu’il a congneu quel bien par rime on a.
Outre l’utilisation du vers et de la rime, qui est déjà en soit une contraintes, Marot nourri son épître au Roi d’un double sens. Ce poète fait partie des précurseurs d’une série de plagiaire par anticipation légendaire.
Les jeux de langues de la Pléiade préfiguraient ceux de l’Oulipo par lesquels on peut explorer le langage et ses abîmes les plus profonds. On compte parmi les plagiaires par anticipation des poètes alexandrins, des grands rhétoriqueurs, la Pléiade, certains poètes baroques allemands, des formalistes russes, des écrivains comme Raymond Roussel et Robert Desnos (avec ses jeux sur les sons) et la comedia dell’arte. Reprenons la démarche de ces poètes (ceux du XVI et XVII siècle). Ils vinrent s’assôirent sur les mots lorsque le français n’était encore qu’une langue naissante et ils nourrissaient le désir de l’enrichir, de la sortir de son trou, ils inventèrent, de fait, des mots ou des formes (autrement appelées contraintes) pour élever cette idiome, pour en faire une utilisation poétique et littéraire. Le groupe de la Pléiade se donne pour mission de définir de nouvelles règles poétiques. Dans ce cadre, du Bellay rédige en 1549 une « Défense et illustration de la langue française ». Il y prône l’usage du français en poésie, contre celui du latin, jusqu’alors quasi-exclusif. Son projet est de rendre la langue française moins « barbare et vulgaire » en l’enrichissant avec ses amis de la Pléiade. Il souhaite également re-populariser les genres poétiques utilisés pendant l’antiquité ainsi que l’élégie, le sonnet, etc.…. Ces occupations permettent d’explorer les potentialités de la langue française à un moment où celle-ci est en train de se stabiliser : ces poèmes ont une fonction d’illustration de la langue et c’est en cela que l’activité de ces poètes augure les recherches et exercices de l’Oulipo sur la potentialité linguistique.
Lorsque, en 1960, Queneau et Le Lionnais fondent l’Oulipo, c’est avec «l’idée d’injecter des notions mathématiques inédites dans la création romanesque ou poétique». En ce sens, la démarche de l’Oulipo s’inscrit, tout en l’infléchissant, dans une filiation quintilienne : on rappellera qu’au livre I de l’Institution oratoire, Quintilien pointe les rapports qui existent entre rhétorique et mathématique, les repérant essentiellement dans le processus démonstratif (l’une des branches de la rhétorique). Quintilien fait donc office de plagiaire par anticipation.
Mallarmé s’illustre comme tel, au même titre que Verlaine, par l’utilisation de la musique dans la poésie.
Peuvent être nommé plagiaire par anticipation tout auteurs ayant créés ou utilisés une forme ou une contrainte. Tous les écrivains cités dans la partie sur les contraintes du passé sont des plagiaires par anticipation.
IV
LA LITTERATURE POTENTIELLE
« Prenez un mot, prenez en deux, faites cuire comme des œufs, prenez un petit bout de sens puis un grand morceau d’innocence, faites chauffer à petit feu au petit feu de la technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et puis mettez les voiles. Où voulez vous donc en venir ? A écrire vraiment ? A écrire ? »
Raymond Queneau
a) Echantillons de diverses contraintes (synthoulipisme).
Cette partie ne se veut pas être une liste là encore des différentes contraintes Oulipiennes ; elle tend à en montrer quelque unes et à les expliquer.
La littérature combinatoire est une contrainte faisant appelle aux mathématiques (plus particulièrement à des notions établis par Leibniz mais qui prirent tout leur sens à notre époque avec l’astrophysique et les algorithmes informatique).
Pour en donner définition il faut s’appuyer sur le concept de configuration ; on cherche une configuration chaque fois que l’on dispose d’un nombre fini d’objets, et que l’on souhaite les disposer de façon à respecter certaines contraintes fixées à l’avance. De même que l’algèbre étudie les opérations, l’analyse étudie les fonctions, la combinatoire étudie, elle, les configurations. Elle veut démontrer l’existence de configurations d’un type voulu, les dénombrer, etc.… (Elle permet de créé un programme informatique pouvant prévoir comment et dans quelle ordre pousseront les feuille d’un arbre qui n’est encore qu’une graine)
Cette étude a dégagée un grand nombre de concepts mathématiques (autrement appelés dans l’Oulipo : manipulation péri mathématique) aisément extrapolable dans le domaine du langage. L’Oulipo s’immisce dans cette catégorie.
La première œuvre de littérature combinatoire est les cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau. Dans ce recueil l’auteur intègre 10 sonnets de 14 vers, ce qui « combinatoire ment » fait 1014 poèmes différents et qui respectent les règles ou contraintes du sonnet (voir précédemment).
Il existe d’autre forme de littérature combinatoire comme « s+7 » qui consiste à prendre un substantif (s), un verbe (v), etc. et à prendre dans un dictionnaire son correspondant 7 place après la sienne.
Mais sa forme la plus intéressante consiste a transposé des concepts existants dans les divers branches des mathématiques dans le domaine de la littérature.
Par exemple un poème de 10 mots monosyllabiques ; le récitant (en appliquant un concept dit « source ») pourrait inter changeait ces mots et obtenir 3 628 800 poèmes. Avec « n » mots à permuter, le nombre des possibilités serait « factorielle « n » ». (n ! = 1x2x…x n).
En 1965 Saporta publie un roman « factoriel » dont les pages peuvent être lues dans n’importe quel sens.
Une autre forme de poésie combinatoire est celle dites «fibonaccienne» (texte décomposé en n éléments et que l’on récite en utilisant seulement les éléments qui n’était pas juxtaposés dans le texte original) parce qu’avec n éléments, le nombre de poèmes n’est autre que le nombre de fibronacci :
Fn = 1+n ! + (n-1) ! + …
1 ! (n-1) 2 ! (n-3) !
Ce qui fait quelque chose comme cela :
« Feu filant,
Déjà sommeillant,
Bénissez votre
Os
Je prendrai
Une vieille accroupie
Vivez les roses de la vie ! »
Pour des exemples, consulter les cent milles milliards de poèmes. Sinon considérons cela : Le mot « CELLULE ». Le nombre de mots possibles (avec ou sans signification) que l’on peut écrire en permutant ces 7 lettres est :
P7 = 7 !
2 !3 !
= 420 mots possibles
Remarque : En considérant deux groupes de lettres identiques : L (3 fois) et E (2 fois). Voila une utilisation (fort simple et basique) de la combinatoire. Cette branche des mathématiques fait vraisemblablement partie des plus complexe, du moins à un certain niveau. Avec Oulipo il existe 360 combinaisons.
La distributivité, la factorisation, la théorie des ensembles, les algorithmes, la théorie des graphes, sont des pistes de courses potentielles vis-à-vis de cette contrainte pour le moins particulière mais oh combien passionnante.
La méthode S+7 dont Jean Lescure est l’inventeur : il expose la méthode du S+7 lors d’une des premières réunions de l’Oulipo, le 13 février 1961. La méthode S+7 consiste à remplacer chaque substantif (S) d’un texte préexistant par le septième substantif trouvé après lui dans un dictionnaire (S+7) donné.
« L’Étranger » de Baudelaire devient « L’étreinte » :
Qui aimes-tu le mieux, homochromie ennéagonale, dis ? Ta perfection, ton mérinos, ta soif ou ton frétillement ?
Je n’ai ni perfection, ni mérinos, ni soif, ni frétillement.
Tes amidons ?
Vous vous servez là d’un paros dont la sensiblerie m’est restée jusqu’à ce jouteur inconnue.
Ton patron ?
J’ignore sous quel laudanum il est situé.
Le bécard ?
Je l’aimerais volontiers, défaut et immortel.
L’orangeade ?
Je la hais, comme vous haïssez Différenciation.
Eh ! Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étreinte ?
J’aime les nucléarisations… les nucléarisations qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleuses nucléarisations !
Il existe de nombreuses variations de cette contrainte. Raymond Queneau propose des variations sur S+7, en l’étendant à d’autres parties du discours. Ainsi La cimaise et la fraction est-elle le résultat d’un « A (adjectif) +7, Sm (substantif masculin) +7, Sf (substantif féminin) +7, V (verbe) +7 » appliqué à la fable bien connue.
La cimaise ayant chaponné tout l’éternueur
Se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie :
Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou de verrat. […]
La liste de ces variations est encore longue et délicieuse.
Parlons à présent de la littérature définitionnelle. Cette contrainte fut créée en 1966 par Queneau, Bénabou et Perec. Dans un énoncé donné, on remplace chaque vocable signifiant (substantif, adjectif, verbe, adverbe) par une de ses définitions dans un dictionnaire donné ; on réitère l’opération sur le nouvel énoncé obtenu, et ainsi de suite.
Soit un énoncé de départ simple : Le chat a bu le lait
Etape 1 : Le mammifère carnivore digitigrade domestique a avalé un liquide blanc, d’une saveur douce fournie par les femelles des mammifères
Etape 2 : Celui qui a des mamelles, mange de la viande, marche sur l’extrémité de ses doigts et concerne la maison a fait descendre dans le gosier par l’estomac un état de la matière sans forme propre, de la couleur du lait, d’une impression agréable sur l’organe du goût et procuré par les animaux du sexe féminin qui ont des mamelles.
La encore une extension existe : la LSD ou littérature semi définitionnelle.
La littérature en arbre nous renvoie à la théorie des graphes dont l’histoire des 3 alertes petits pois est un exemple. Elle peut être utilisé pour du théâtre, un poème, des nouvelles. Le récit, les rencontres, les images ou autre se feront selon un graphe donné. En exemple, nous vous invitons à considérer Chamboula de Paul Fournel. Sinon voila l’exemple d’un arbre.
Une autre contrainte qui fit époque dans l’enchaînement des longs siècles oulipiens fut la morale élémentaire de Raymond Queneau. Il la définit ainsi : “ D’abord, trois fois trois plus un groupes substantif plus adjectif (ou participe) avec quelques répétitions, rimes, allitérations, échos ad libitum ; puis une sorte d’interludes de sept vers de une à cinq syllabes ; enfin une conclusion de trois plus un groupe substantif plus adjectif reprenant plus ou moins quelques-uns des vingt-quatre mots utilisés dans la première partie. ”
Voir ci-après, morale élémentaire de Queneau.
Soleil roux Lune rousse Etoiles blondes
Noms sphériques
Fleur bleue Métaux mûrs Horizons lustrés
Gestes lyriques
Herbe rase Cygne immense Epervier volant
Aigles algébriques
un moineau
dans l'ormeau
pépie
un long chant
présent
sur la route
se déplie
Soleil brun Vénus verte Sirius blond
Noms sphériques
Noms sphériques
Fleur bleue Métaux mûrs Horizons lustrés
Gestes lyriques
Herbe rase Cygne immense Epervier volant
Aigles algébriques
un moineau
dans l'ormeau
pépie
un long chant
présent
sur la route
se déplie
Soleil brun Vénus verte Sirius blond
Noms sphériques
Voila un autre exemple que nous donnerons de cette forme pour le moins déroutante, proche du haïku japonais mais ô combien délicieuse.
Cours ennuyeux Pluie battante Matin hivernal
Mots attirants
Stylo orgueilleux Feuille séduisante Papier pâle
Abîme béant
Lexèmes merveilleux Encre filante Morale matinale
Texte brûlant
Un mot bouge,
Ils s’agitent,
La phrase se tord,
Brûle et s’effrite.
Si musique ne dort
Le rythme sautille ;
Voila Poésie !
Cours terminée Stylo fermé Feuille pliée
Morale oubliée
Mots attirants
Stylo orgueilleux Feuille séduisante Papier pâle
Abîme béant
Lexèmes merveilleux Encre filante Morale matinale
Texte brûlant
Un mot bouge,
Ils s’agitent,
La phrase se tord,
Brûle et s’effrite.
Si musique ne dort
Le rythme sautille ;
Voila Poésie !
Cours terminée Stylo fermé Feuille pliée
Morale oubliée
L’alphabet du prisonnier est une contrainte ayant pour but de se priver des lettres à jambages ; c’est donc un lipogramme en b, d, f, g, h, i, j, k, l, p, q, t, y. Le nom de cette contrainte vient de l’image d’un prisonnier ne disposant que de très peut de place pour écrire et qui essaye donc de l’économiser. Nous en donnerons un modeste exemple.
Un cœur écumé envie vos amours, car une scène inavouée crève mon âme à ses rêves marins comme une mer sous un navire emmené sur son sein. Ainsi moussées océanes, aimez ! Aimez ! Comme mon cœur vénère une immense rose amoureuse et rêvassée ; si une vie ne vous va, six m’irons assez.
Il existe des variantes de cette forme, à savoir son inverse : la contrainte du prisonnier libéré, où l’on ne doit utiliser que les voyelles et les lettres à jambage.
Un beau présent est une contrainte inventée par Georges Perec, qui consiste en l’unique utilisation des lettres du nom de la personne à qui s’adresse le poème. Hervé Le Tellier déclare au sujet de cette contrainte : “le « beau présent », par exemple, où l’on s’impose de n’utiliser que les lettres présentes dans des noms et prénoms, suscite des alliances qu’aucune muse n’aurait pu souffler “.
V
LE SENS DE LA DEMARCHE OULIPIENNE
« Au fond, je me donne des règles pour être totalement libre ».
Georges Perec
a) L’Oulipo et l’Esthétique.
Dans son essai sur l’Esthétique de l’Oulipo, Le Tellier déclare : « Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Nous avons vu dans l’introduction qu’en effet le groupe le prétend pas s’unir autour d’une quelconque notion d’esthétique, ce qui de fait ferait de lui un mouvement littéraire.
Ouvrir de manière si emportée un discours sur un sujet aussi fin et délicat que l’esthétique… N’est ce pas la une chose bien curieuse ? Et puis, de la littérature… sans esthétique ?
Pour répondre à de telle questions et comprendre dés lors le sens de la démarche oulipienne, il convient de s’arrêter un instant sur le concept de l’Esthétique.
Dans le langage courant il définit ce qui est beau, agréable aux sens. Ce concept est en fait récent puisqu’il est né au XVIII siècle sous la plume de Baumgarten en tant que néologisme et en tant que nouvelle branche d’étude de la Philosophie. Il procède du grec αισθητική (aisthetike) « sensation, perception », de αίσθησιν (aisthesin) « sens ». Dans son ouvrage Méditations philosophiques (1735), Baumgarten explique son néologisme d’esthétique comme « la science du mode de connaissance et d’exposition sensible », puis dans Æsthetica (1750) : « L’esthétique est la science de la connaissance sensible ». Au XIX siècle ce mot est adopté par la langue française, jadis, on parlait plutôt de « théorie de l’art » ou de « critique d’art ». Dans sa définition la plus évasée, l’esthétique reste une science qui a pour sujet d’étude l’essence et les perceptions du beau, les jugements et émotions qui découlent de ces impressions ainsi que l’art sous tout ces formes et aspects.
L’esthétique peut être prise comme une science normative du beau, au même titre que la morale est celle du bien et la logique celle du vrai. Au-delà de la simple science, elle fut prise comme une métaphysique du beau (entre autre par Platon avec sa théorie des idées) dans le sens où elle se concentrer sur l’inintelligible dans la matière, le reflet de l’idée, de la volonté ou de l’être selon d’autre philosophe (Hegel par exemple).
Ce tableau de Hans Makart illustre des conceptions d’ordre esthétique (le beau chez la femme) mais il émet aussi l’idée que la perception du beau s’effectue par les cinq sens. La littérature est donc ici très à propos.
Les théories esthétiques littéraires sont surtout chevillées par Aristote dans sa Poétique (ces principes seront repris par Boileau pour l’esthétique classique). Il y défend entre autre l’utilisation des figures de style pour le plaisir du récepteur.
Mais nous ne souhaitons pas faire un historique de la pensée sur le concept de beau, laissons cela à des encyclopédies ; Pourquoi ? Parce que nous en avons vu suffisamment pour comprendre ce que Hervé Le Tellier déclare ! L’esthétique est une théorie normative, normale, qui fixe donc des normes. Or L’Oulipo n’obéit pas à de telles considérations ; l’unité, l’existence même du groupe ne repose pas sur des conceptions communes esthétiques. Le classicisme se tenait droit face à des normes esthétiques définit entre autre par Boileau. Le Romantisme unissait les encres autour de la nature, l’amour, la mort et le goût pour les époques mortes. Le symbolisme fixé la barre autour de l’utilisation d’un langage mystique, symbolique, transcendant l’existence par l’utilisation de correspondances. Le surréalisme flottait accroché aux amarres du rêve et de l’inconscient. Que de belles choses, n’est ce pas ? L’Ouvroir de Littérature Potentielle n’a pas cela ; la contrainte et le refus d’une pseudo inspiration voila les mots d’ordres de l’Oulipo. Paul Fournel dit que l’Oulipo ne prétend en rien obéir « à une esthétique orthodoxe », il serait sinon un mouvement littéraire comme expliquer dans l’introduction de ce travail. Le fait de ne pas se soumettre à une telle orthodoxie ne signifie pas que l’Oulipo n’est pas producteur d’une certaine esthétique ; en effet où serait alors la littérature ? Chaque auteur oulipien possède un but esthétique en écrivant, il n’est en rien fixé dans un manifeste (même si il en existe un, il ne parle pas de cet aspect qui est alors laissé à l’appréciation de chaque oulipiens). Prenons je me souviens de Perec, les amnésiques n’ont rien vécus d’inoubliable de Le Tellier, Foraine de Paul Fournel, les romans de Queneau ainsi que ses morales élémentaires… Que de littérature respirant le beau, l’esthétique, une originalité propre a chaque auteur, des conceptions différentes du monde, de la vie, du quotidien et des autres broutilles qui nous entourent ! Tout comme Van Gogh, les membres de l’Oulipo ne peuvent être classés selon des considérations esthétiques ; ils sont oulipiens, littérateur à contraintes (rats dans un labyrinthe), ils ne font pas partie d’un courant, si se n’est celui qui est propre à chacun d’en
- RichardTri aime ceci


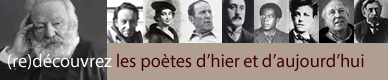
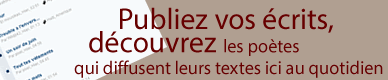
 Créer un thème personnalisé
Créer un thème personnalisé





Je viens d'ouvrir un blog pour la survie des lettres et de la pensée au XXIe siècle :
http://cognitium.over-blog.com
Merci
Bien à toi